
ÉPILOGUE
L’histoire de la folie semble n’avoir jamais pu s’affranchir de ce dualisme manichéen qui, en séparant le corps de l’âme, a paralysé la pensée médicale et scientifique à toutes les époques.
Ainsi, au cours des siècles, la folie est apparue tantôt comme une maladie organique, soumise aux méthodes rationnelles de la médecine classique, tantôt comme une pathologie spécifique de l’âme qui engage la philosophie.
Mais de ces deux considérations inconciliables sont nées des attitudes thérapeutiques différentes. Et c’est dans cette dialectique, faite d’incertitude et de confusion, que la psychiatrie a trouvé son évolution.
Si elle est parvenue à se déterminer comme une “indispensable philosophie” ayant pour tâche de s’occuper de l’âme humaine, d’en comprendre et d’en contrôler les débordements, elle n’a pu le faire qu’en occultant difficilement le langage organique et biologique que lui a enseigné la médecine. Elle a ainsi traité du subjectif, du psychisme en faisant référence aux humeurs sèches ou humides, à la “bile noire”, à la maladie des “organes du cerveau” de Voltaire ou de Morgagni, aux bosses du crâne de Gall, Cardan ou Lombroso, aux théories de la dégénérescence, etc...
Toutefois, si les explications organiques, biologiques ou neurologiques ont cherché à s’imposer avec force, elles n’ont pas réussi à empêcher Platon, Socrate, Aristote et tous les défenseurs de la philosophie de revenir sans cesse parler de la folie comme d’un phénomène “psychologique et social”.
L’histoire a témoigné maintes fois, d’une façon incontestable, que la maladie mentale ne peut pas se réduire à n’être qu’une “ratée de la mécanique”, un simple trouble organique. Elle ne traduit pas non plus une perte complète de la raison, ni un retour à l’animalité, ni une possession diabolique ou une faute, un égarement passionnel à punir et à corriger. Le mal semble ne pas atteindre qu’une cellule ou qu’un organe, mais l’être humain dans toute sa subjectivité, au travers de ses difficultés dans l’existence, dans ses expériences et ses comportements.
C’est à partir de ces réflexions essentielles, dans cette dialectique où il devient parfois difficile de distinguer le médical du philosophique, le normal du pathologique, qu’est née l’idée d’une psychiatrie. Son territoire est donc très étendu puisqu’il concerne aussi bien la médecine et les neurosciences que la psychologie, la philosophie, la sociologie, l’éthique, l’histoire, le droit, etc...
Tout réductionnisme risque d’aboutir à une impasse. En divisant, en simplifiant, on croit pouvoir échapper à l’incertitude et au manque de rigueur alors que l’on s’éloigne davantage de toute compréhension. Se limiter aux symptômes, en rédiger des listes universelles, c’est rester ignorant de l’étiologie et du sens de la maladie. Les innombrables tentatives de classifications, répétées au long des siècles, n’ont ainsi jamais débouché que sur des descriptions stériles...
Par l’approche philosophique et psychologique, la folie apparaît comme une expérience qui ne nous est pas complètement étrangère et qui peut même éclairer la raison. Les comportements les plus insensés, caricatures des comportements normaux, font partie du potentiel humain. L’homme est capable d’être fou parce qu’ il possède ces qualités que l’animal n’a pas : il peut parler, créer, inventer, imaginer, rêver... Et ces formidables instruments de communication sont ceux justement par lesquels s’exprime la folie. Pathologie de la communication, elle atteint l’être humain dans sa dimension la plus profonde – dans sa pensée, sa volonté, ses sentiments, ses émotions – dans ce qui le détermine comme un individu participant à une vie collective.
Le malade, malgré la rupture des liens avec l’environnement, malgré la perte de contact avec la réalité, continue d’exprimer quelque chose aux autres, son mal de vivre, sa difficulté à être accepté. Sa folie conserve toujours, à travers cette tentative de dialogue, une fonction sociale. Mais trop souvent, elle n’échappe pas à ce jugement moral qui la condamne à l’obligation de traitement, à l’isolement et à l’exclusion . Alors le patient s’enferme dans son monde, dans son délire et sa souffrance, et devient tout aussi incompréhensible que dangereux.
S’inspirant de la philosophie, de la psychologie et de la sociologie, une nouvelle conception de la folie est apparue au cours du XX e siècle. La psychiatrie s’est alors donnée pour mission de remplir une fonction sociale, d’intervenir partout où la souffrance psychique pouvait se manifester.
La notion de “Santé Mentale” s’est imposée et avec elle les idées de sectorisation, de prévention et de prophylaxie. Il s’agissait de réguler la sécrétion de la “bile noire”, de prendre en charge les maux de la cité en dehors des murs de l’hôpital afin d’éviter la condamnation et l’enfermement.
Une alliance, une solidarité a existé entre les pouvoirs administratifs et les professionnels de la santé pour maintenir le malade dans son milieu de vie, pour y favoriser son retour, le protéger et restaurer ses liens de communication avec son entourage.
Ce changement d’orientation a marqué le passage à un autre jugement porté sur la folie et surtout la fin d’une tradition asilaire. On a compris que ce n’est pas dans l’institution que l’on doit rechercher l’étiologie des troubles, mais bien à l’extérieur, là où justement la psychiatrie trouve sa véritable utilité. La maladie semble effectivement ne pas pouvoir se passer du milieu qui lui a donné naissance et qui lui permet d’exister. C’est le contexte socioculturel qui en apporte la meilleure explication. Suivant les coutumes, les situations, les modes de vie, l’expression des symptômes varie, ce qui prouve que la folie reste intimement liée à la société et qu’elle évolue avec elle. Elle appartient à tout un groupe qui partage avec le malade sa souffrance et ses comportements pathologiques, parfois peut- être sur plusieurs générations. Lui enlever cette référence, c’est l’isoler dans un individu, dans une expérience solitaire où elle n’a plus de sens.
Pour comprendre le patient, il faut le considérer comme un être humain vivant en collectivité et non pas comme un simple présentateur de symptômes anormaux.
Et se contenter de supprimer les manifestations visibles de la maladie ne guérit pas mais risque d’accentuer encore davantage l’aliénation.
Mais la psychiatrie n’a hélas jamais pu disposer des moyens essentiels de changement ou de mise en place de ses projets. Des impératifs économiques se sont heurtés aux objectifs de prévention et de lutte contre l’exclusion. Le discours sur la folie, dans sa dimension sociale, a peu à peu été occulté. L’ouverture de la psychiatrie sur la cité n’est restée qu’une utopie.
Un pouvoir administratif soucieux d’imposer ses restrictions délimite maintenant le soin avec une logique technocratique qui permet à l’ordre médical de revenir en force.
Les mécanismes biologiques, les phénomènes moléculaires, toute une alchimie cérébrale, utilisant un déterminisme savant, redéfinissent la folie comme une “maladie des organes du cerveau”.
La tomodensitométrie, l’IRM, l’étude des débits sanguins par le Xénon 133 métabolisent la pensée, assurent à l’anatomie et à la physiologie le pouvoir de tout comprendre et à la chimiothérapie, celui de tout maîtriser.
Avec un tel rationalisme, la psychiatrie s’éloigne de plus en plus de sa fonction sociale, celle qui justement devait chercher à réunifier le biologique, le psychologique et le sociologique afin d’envisager l’être humain dans cette indissociable unité.
Gouverné par les neurosciences, le soin perd tout son sens en s’alignant sur le modèle médical. On traite comme en médecine, on divise, on découpe, on sépare. Les pathologies mentales sont émiettées en de longues listes de symptômes qui nous font croire à des maladies différentes. En réalité, la divergence n’existe que dans la façon d’exprimer le mal, elle n’est que superficielle. À l’origine de toutes ces manifestations, on retrouve toujours les mêmes évènements traumatisants, la même blessure indéracinable dans l’organisation psychique. La forme d’expression change, d’un patient à un autre, et le médicament la supprime, mais il ne change pas le fond. Le trouble originel reste ignoré.
C’est finalement le symptôme, plus que le malade, qui fait l’objet d’un traitement.
Les neuroleptiques, appartenant pourtant tous à la même molécule de base, sont sensés pouvoir à la fois calmer l’agitation et combattre la passivité. Alors on dissocie les prescriptions et on voit deux personnes différentes, l’une agitée, l’autre apragmatique, là où en fait, il n’y en a qu’une.
Il y a des clivages, des découpages, des isolements dans notre façon de traiter la maladie mentale, qui aliènent plus qu’ils ne soignent. Ils appartiennent à l’ordre médical auquel la psychiatrie s’est conformée.
D’abord, on sépare le sujet malade de son milieu, qui bien souvent est lui-même pathologique. Mais seul celui qui dérange, qui perturbe est enfermé. Le contexte familial ou social reste inchangé, de sorte que lorsque le patient retourne chez lui, il retrouve les mêmes conditions qui ont provoqué sa décompensation.
Ensuite, non seulement on fragmente toutes les pathologies en multiples symptômes que l’on traite individuellement, mais on établit aussi une sélection, un partage parmi les patients.
On sépare les “actifs” des “passifs”, les chroniques des non chroniques, ceux qui sont du domaine de la justice et ceux qui sont du domaine de la psychiatrie, ceux pour lesquels on peut espérer une amélioration et ceux pour lesquels on conclut que l’on ne peut plus rien et dont il faut se débarrasser.
De la même manière, on sépare le soignant de l’administratif ou encore l’interne du psychiatre, celui qui s’occupe du corps et celui qui s’occupe de l’esprit.
Les malades sont soignés par morceaux, par étapes, dans des endroits différents, dans des structures cloisonnées.
Dans cette psychiatrie éparpillée, éclatée, l’unification semble impossible. Certes, on parvient à isoler le symptôme et à le faire disparaître, mais la connaissance que l’on a du patient n’est jamais suffisante pour prétendre assurer un soin cohérent.
Nos raisonnements médicaux trop matérialistes n’accordent plus de place au psycho relationnel. Et pourtant le cerveau n’est pas qu’un système de molécules chimiques, il déborde largement de la simple organicité dans laquelle on l’a enfermé. Situé au croisement du physiologique et du psychosocial, il est un immense réseau de multiples connexions qui unifie le corps et l’esprit et où se loge l’histoire du malade et celle de la société. La folie a de profondes racines culturelles et le symptôme qui affleure ne représente que la partie émergée de l’iceberg, ce n’est qu’un effet de surface qui dissimule avec ses apparences trompeuses.
La psychiatrie a délaissé sa fonction sociale. Elle préfère faire confiance au médicament, à l’énumération des troubles, à l’uniformisation du soin. La pensée isolée, le discours individuel, le symptôme du patient s’éradiquent facilement devant cette nécessité économique qui uniformise, rédige tout prêt, rend conforme et fait des groupes homogènes de malades et de soignants.
Si le XX e siècle a réalisé d’énormes progrès scientifiques, il a par contre délaissé complètement le côté humain.
La tentative ratée de la sectorisation en est une triste illustration.
Le besoin de tout maîtriser et de tout dominer font que la souffrance et la maladie sont devenues des choses que l’on n’est plus capable de tolérer aujourd’hui.
Cependant la folie résiste et se permet toujours de faire reculer les limites de la science et de l’esprit médical. Comme on ne sait pas la guérir, malgré des efforts thérapeutiques aussi variés qu’innombrables, on préfère encore l’ignorer... C’est à dire ne plus la considérer comme la perturbation d’un système collectif, comme la soupape de sécurité d’une société malade, mais simplement comme une “ratée” de la mécanique cérébrale, symptôme isolé facilement identifiable par la mesure de certaines constantes biologiques ou de quelques paramètres génétiques... Ce rationalisme médical s’efforce de découvrir enfin la tare, le virus, le chromosome ou le marqueur spécifique rassurants — pour expliquer la déviance, la violence et la déraison — et le médicament capable d’anesthésier la pensée et d’aseptiser le comportement.
Abandonnant tout espoir psychothérapeutique, on s’achemine progressivement vers un système de soin qui ne prend plus en charge la personne elle-même, mais uniquement son symptôme sur la courte période de l’urgence, le temps d’un traitement chimique qui écourte la crise, qui efface ce qui se voit et qui remet dans les normes.
On oublie que la folie s’enracine bien plus profondément dans la personne humaine et dans un environnement social qui la favorise de plus en plus. À faire taire le symptôme, on risque certainement d’aggraver le mal... À ne plus contenir la folie, on lui permet peut être de trouver de nouvelles formes d’expression dans la société, bien plus difficiles à maîtriser.
Bibliographie
Histoire des maladies mentales
Michel Collée et Claude Quétel
Presses universitaires de France. 1994
Histoire de la psychiatrie
Yves Pélicier
Presses universitaires de France. 1976
Histoire de la psychiatrie
F.G. Alexander et S.T. Selesnick
Armand colin. 1972
Histoire de la folie à l’âge classique
Michel Foucault
Gallimard. 1972
Le secteur psychiatrique
M. Claude George et Yvette Tourné
Presses universitaires de France. 1994
DSM III - DSM IV
Manuels diagnostiques et statistiques des troubles mentaux
Masson. 1987-1994
Les nouveaux visages de la folie
J.Pierre Olié et Christian Spadone
Odile Jacob. 1993
Des paradis plein la tête
Édouard Zarifian
Odile Jacob. 1994
La folie Histoire et dictionnaire
Jean Thuillier
Robert Laffont. 1996
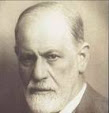
1 commentaire:
J'ai vu un membre de ma famille disparaître derrière ces traitements médicamenteux...Qui peu à peu lui ont éffacé tout espoir de guérison, ou d'aller mieux.Le traitement humain c'est lui qui donne l'espoir de guérison, et la certitude que malgré la maladie mentale, on fait encore partie de la société.
Enregistrer un commentaire