
XX e SIECLE : 2ème PARTIE
1
LA PSYCHIATRIE S’IMPOSE
La chlorpromazine et les autres psychotropes offrent à la maladie mentale la possibilité de s’exprimer autrement.
Et, à cette incidence des médicaments, se joint une nécessaire redéfinition de la souffrance psychique qui ne semble plus concerner uniquement les aliénés.
Le changement, qui s’amorce dans l’asile, s’accompagne aussi d’une évolution dans la considération sociale de la folie.
-La rupture avec le passé dans l’asile :
Les neuroleptiques, qui remplacent peu à peu les électrochocs et les narcotiques, permettent aux patients de s’ouvrir à leur médecin.
Alors qu’auparavant on s’efforçait d’éviter le « syndrome de la tête contre les murs », que la folie signifiait violence, agitation et hurlement, le médicament ramène le silence dans les hôpitaux.
Les hallucinés, les gesticulants, les dévorés d’angoisse ou les catatoniques retrouvent la possibilité de s’exprimer par la parole.
Une communication s’établit enfin entre le soigné et le soignant, qui commence à ébranler le mur d’incompréhension qui les séparait.
La privation de liberté, la contrainte, les punitions,les sévices de tous ordres ne sont plus des conduites systématiques. Aux internements abusifs et à vie se substituent des placements de plus courte durée.
Et grâce à la psychopharmacologie, il est enfin possible de répondre à cette nécessité maintes fois affirmée en psychiatrie : changer les fonctions de l’asile et humaniser les conditions de détention des aliénés.
L’hôpital doit mériter son appellation.
Le 10 Août 1949, une circulaire ministérielle institue le placement volontaire gratuit. Le malade, hospitalisé contre sa volonté, est pris en charge financièrement par la collectivité.
Parce que son internement doit représenter un soin plus qu’une mesure d’exclusion.
Cet espoir thérapeutique se concrétise en Juillet 1955 par l’institution du premier diplôme d’infirmier psychiatrique. Les anciens gardiens, qui, sans qualification spécifique et en général d’un niveau d’étude très bas, venaient « garder les fous » et faire de la contention, en double journée ou pour un travail saisonnier, sont remplacés par des infirmiers. Ceux-ci seront forcément porteurs du mouvement désaliéniste. Et même si leur diplôme n’a pas et n’obtiendra d’ailleurs jamais l’équivalence d’un diplôme d’État, il est le témoin et le garant d’une certitude maintenant acquise : la folie réclame un soin, elle est devenue l’objet d’une préoccupation médicale.
La découverte des premiers psychotropes a révélé cette nécessité de disposer d’un personnel qualifié pour s’occuper des malades mentaux. Et, en toute logique, dans une période entièrement convaincue des prouesses de la neurochimie, c’est le statut d’infirmier, avec toute son ambiguïté, qui s’est imposé, limitant déjà trop le soin à la seule prescription médicale.
Et pourtant, au travers du bénéfice apporté par l’usage du médicament, on entrevoit rapidement une autre façon de considérer et de prendre en charge le malade et sa maladie. Il y a place pour la psychologie. C’est elle surtout qui va provoquer la rupture avec la tradition asilaire.
Désormais le fou n’est plus condamné à passer sa vie enfermé. Et, quand on l’écoute, on se rend compte que sa parole et son histoire personnelle traduisent sa souffrance et apparaissent comme les éléments essentiels sur lesquels peut se baser une relation d’aide thérapeutique.
L’hôpital, après avoir été un lieu de mort, doit devenir un lieu de vie, un lieu où l’on réapprend à vivre, à reconstruire son existence et à se réadapter à une réalité sociale.
Il faut en finir avec cette pratique asilaire qui a conduit à l’ankylose, à la dépersonnalisation et à la chronicisation des pathologies.
Le malade doit vivre sa vie et non plus celle de l’institution, qui avait « clôturé » les patients sur eux-mêmes en les soumettant à la servitude passive, à la perte de l’initiative, à l’obéissance et à un jugement coercitif.
L’hôpital se transforme. Il représente une société miniature, prélude à la future réinsertion.
L’idée d’une psychothérapie institutionnelle, évoquée par Esquirol en 1805, refait surface :
« Une maison d’aliénés est un instrument de guérison... »
Et l’on reconsidère encore que ce rôle curatif est lié à l’amélioration des conditions de détention. Alors on fait installer le chauffage central, des chambres plus confortables, des sanitaires.
On autorise l’utilisation des fourchettes et des couteaux à bout rond. Les habits personnel sont tolérés.
Parallèlement se mettent en place des ateliers d’ergothérapie.
Le soin n’est plus seulement un geste médical qui concerne le psychiatre et l’infirmier, des psychologues et des assistantes sociales y participent aussi. La maladie mentale est envisagée dans toutes ses dimensions.
C’est ainsi qu’apparaît la nécessaire perspective de la sectorisation, c’est à dire la possibilité de prendre en charge les patients en dehors des murs.
L’utilisation des médicaments, qui vient accélérer l’évolution des considérations sur la folie, déjà sensible depuis la fin de la guerre, se traduit, dans de nombreux pays, par une baisse importante de la population asilaire.
Aux USA, par exemple, de 500 000 malades mentaux recensés en 1950, on passera à 215 000 en 1974.
En Europe, un phénomène identique se produit.
Et alors que le nombre de patients ne fait que décroître, celui des psychiatres ne cesse d’augmenter et sera multiplié par huit au cours des trente années qui vont suivre.
Toutes les circonstances qui concourent au changement de la psychiatrie répondent à une même exigence : humaniser la folie. C’est à dire réduire le plus possible l’enfermement, ne plus en faire un instrument de punition et d’exclusion. L’hôpital doit être le lieu d’un soin qui prépare le retour à la vie extérieure.
A côté des immuables conceptions organiques de la neurologie, apparaît une médecine psychiatrique de la personne qui cherche à considérer le malade comme un être humain dont la pathologie peut aussi s’exprimer d’une manière psychologique et sociale.
Et cette façon différente de comprendre et de traiter la folie est à l’origine d’un changement du visage de cette même folie :
La paralysie générale, véritable fléau du début du siècle, qui concernait 20% des malades internés, disparaît grâce à la pénicilline.
On assiste de moins en moins à ces grandes crises d’hystérie, accompagnées de paralysies, d’anesthésies et de tremblements, si fréquentes auparavant. Cette pathologie se modifie pour s’exprimer davantage par de l’angoisse, de l’insomnie, une espèce de douleur morale imprécise associée à des troubles caractériels ou psychopathologiques.
La mélancolie, réputée jusqu’alors pour être une maladie chronique présentant des formes sévères et incurables, telles que le délire de négation ou le syndrome de Cotard, remplissait les asiles.
Les médicaments transforment le tableau clinique et permettent à 30% des malades de connaître une réelle amélioration.
Les symptômes de la grande dépression s’atténuent. Il devient difficile de différencier avec certitude les troubles présentant la gravité d’une maladie mentale, de ceux qui caractérisent le mal de vivre ou la souffrance existentielle de la société des gens « normaux ».
Le pourcentage de lits occupés par des malades atteints de psychoses chroniques et de pathologies lourdes comme la schizophrénie passe, en quelques décennies, de 75% à 25%.
-La reconnaissance sociale de la folie :
L’effet du médicament, conjugué à une volonté affirmée de changer l’asile, fait entrer la psychiatrie dans une période de mutation où la folie elle même, par contre coup, s’en trouve transformée.
On entrevoit ainsi la possibilité de la faire vivre à l’extérieur en organisant un système de soins éloigné des lieux de l’exclusion. Ce projet entraîne, en quelques années, une libéralisation, une démystification de la psychiatrie. Son vocabulaire se répand dans le langage social et les connaissances sur la maladie mentale sont vulgarisées.
La présence du fou dans la collectivité devient un sujet d’actualité très médiatisé. Il semble avoir retrouvé un certain droit de cité.
Soulager, améliorer ou guérir la souffrance psychique est un impératif qui ne concerne plus seulement les malades internés. On se reconnaît dans le fou, sa pathologie n’est pas complètement incompréhensible et ses débordements ne nous sont pas étrangers non plus.
Entre normal et anormal, il ne s’agit que d’une question de degré.
Mise à l’ordre du jour au cinéma et dans la littérature, la folie tente de se faire accepter comme une maladie de la société.
La folie au cinéma :
Bedlam :
Film de Mark Robson. USA, 1946.
Révolte dans un asile au XVIII e siècle. Le gardien qui violait
et sadisait les pensionnaires est emmuré.
Psychose :
Film d’Alfred Hitchcock. USA, 1960.
Un criminel se déguise en vieille femme pour accomplir des
meurtres. Une fois incarcéré, il prend la voix de la vieille femme.
Bel exemple d’un dédoublement de la personnalité.
Mère Jeanne des Anges :
Film de Jezzy Kawalerowicz. Pologne, 1961.
Hystérie collective dans un couvent.
C’est la transposition des possédées de Loudun.
Regard sur la folie :
Film de Mario Ruspoli. France, 1962.
Illustrant la citation de JP Sartre : « Tous les hommes ne sont
pas fous, mais tous les fous sont des hommes », ce film raconte
l’expérience de la maladie mentale dans l’hôpital de St Alban.
Shock Corridor :
Film de Samuel Fuller. USA, 1963.
Terrible description de la folie asilaire par un journaliste qui, se
faisant interner pour démasquer un criminel aliéné, devient fou.
Lillith :
Film de Robert Rossen. USA, 1964.
Un médecin tombe amoureux d’une de ses patientes qui l’en-
traîne dans sa folie. Schizophrénie.
La tête contre les murs :
Film de Georges Franju. France, 1958.
L’unique film sur les fous qui ait été réalisé par un fou rescapé de l’asile.
Rosemary’s baby :
Film de Roman Polanski. USA, 1968.
Dans un jeune couple, le mari, la nuit, se transforme en diable.
Sa femme tombe enceinte. Le bébé sera-t-il Satan ?
Sentiment d’étrangeté et de possession.
Le journal d’une schizophrène :
Film de Nelo Risi. Italie, 1969.
La guérison d’une schizophrène.
Orange mécanique :
Film de Stanley Kubrick. Angleterre, 1971.
Un jeune criminel, violeur, subit une lobotomie et y perd le goût
de vivre.
Family life :
Film de Kenneth Loach. Angleterre, 1971.
Le cas d’une famille folle. Usage de l’électrochoc.
Vol au dessus d’un nid de coucou :
Film de Milos Forman. USA, 1975.
Révolte dans un hôpital psychiatrique.
Electrochocs et lobotomies.
Histoire d’Adèle H :
Film de François Truffaut. France, 1975.
La fille de Victor Hugo, amoureuse d’un lieutenant, ne peut
accepter la séparation. Devenue folle, elle est internée jus-
qu’à sa mort.
La folie dans la littérature :
On a constaté qu’à toutes les époques, les philosophes, les écrivains ou les poètes ont su parler de la folie, et que très souvent, ils s’en sont portés défenseurs.
Par humanisme surtout, mais aussi parce qu’ils sont restés convaincus qu’observer, écouter, et tenter de comprendre ceux qu’on a considérés comme aliénés n’est jamais une démarche inutile.
La folie peut aider à percer les mystères de l’âme.
A partir de 1920 et jusqu’en 1960, la littérature s’engage dans le surréalisme avec André Breton, son fondateur, suivi par Aragon, Eluard, Soupault, Desnos, etc...
Breton édite en 1924 le « manifeste du surréalisme » qui est l’acte officiel de naissance de ce mouvement très largement inspiré par la psychanalyse.
Le texte surréaliste fait appel à l’écriture automatique, qui est fondée sur la transcription rapide et sans contrôle rationnel de tout ce qui vient à l’esprit. C’est l’adaptation de la « libre association des idées » . La poésie est un « rêve éveillé », la voie royale qui mène à l’inconscient.
Elle donne la parole à l’instinct, aux désirs, aux fantasmes oniriques, à cet insensé qui habite l’individu normal et qui commande le fonctionnement de sa pensée.
Déjà Voltaire à son époque avait osé cette réflexion :
« Le plus sage des hommes peut-il connaître la folie ? Qu’il réfléchisse sur la marche de ses idées pendant le rêve ».
L’écriture n’est plus considérée comme un acte raisonné. En s’opposant aux conventions morales, elle peut devenir une méthode d’investigation de l’inconscient, de ce qui hante l’être humain dans les profondeurs de sa vie psychique, de cette partie de lui même qui lui donne le sentiment de conserver un lien de parenté avec le fou.
« Dites vous bien que la littérature est le plus triste chemin qui mène à tout ». Vaché
La poésie est la « clé » de la prison mentale. Elle permet de fracturer la porte qui retient prisonnier le désir. Livré tout entier à son imagination, le surréaliste prend le risque de vivre sa poésie, de connaître la folie (Artaud) ou même le suicide (Vaché). Sa liberté est à ce prix.
Mais dans tous les cas, il veut rester responsable de ce qu’il vit, il n’a besoin de personne pour lui dicter sa conduite.
« Toute la science hasardeuse des hommes n’est pas supérieure à la connaissance immédiate que je puis avoir de mon être. Je suis seul juge de ce qui est en moi. »
« C’est une prétention singulière de la médecine moderne que de vouloir dicter ses devoirs à la conscience de chacun ».
« Et si j’ai perdu ma lucidité, la médecine n’a qu’une chose à faire, c’est de me donner les substances qui me permettent de recouvrer l’usage de cette lucidité ».
Antonin Artaud, « Lettre à Monsieur le Législateur de la Loi sur les Stupéfiants », 1925.
Avec le cinéma et la littérature, dans le sillage de la psychanalyse et du mouvement de désaliénisation des hôpitaux, une certaine culture psychologique se répand dans la société.
La folie est à nouveau reconnue comme riche d’enseignement.
L’insensé apporte une connaissance de soi-même, une certaine sagesse, une nouvelle façon de vivre et de concevoir son engagement dans l’existence.
Le fou ne mérite plus cette condamnation qui l’oblige à vivre comme un étranger hors norme à l’écart des autres. Il a le droit d’exister.
De cette prise de conscience va naître le plus grand projet de la psychiatrie : la « sectorisation ».
2
L’INEVITABLE PROJET DE SECTORISATION
L’idée de soigner les malades mentaux en dehors des institutions est une perspective qui s’inclue dans l’histoire de la psychiatrie après la guerre. Mais en fait, l’idée est assez ancienne, puisque les philanthropes du siècle des lumières l’avaient déjà soulevée en s’interrogeant sur les conditions de détention carcérales de ceux que l’on nommait les « insensés ».
E. Toulouse l’a reprise ensuite dans son livre :« Les causes de la folie, prophylaxie et assistance » (1896).
Il condamnait la loi de 1838 et préconisait d’autres modes de prise en charge que celui de la séquestration. D’ailleurs à ce sujet, il aurait dit à Clérambault :
« Vous commencez par interner un malade sans savoir s’il doit l’être ».
C’est surtout après la seconde guerre mondiale, suite au constat d’échec de l’institution asilaire, que débute réellement l’histoire du secteur.
La « circulaire Rucart » établie sous le front populaire en 1937, reprend un rapport présenté au Conseil Supérieur de l’Assistance Publique qui déclare que :
« La notion d’aliéné à isoler doit céder la place à celle de malade nerveux à traiter précocement pour éviter sa chronicisation et qu’il ne devienne ainsi une lourde charge sociale. L’essentiel en matière de prophylaxie mentale est de dépister et de traiter les malades dès la phase prodromique des psychoses. Il faut adjoindre aux asiles des services libres et des consultations externes ».
Il est donc décidé que chaque département, en plus d’une unité d’hospitalisation, devra disposer d’un service de prophylaxie mentale comprenant un dispensaire.
Désormais, il ne s’agit plus seulement d’interner, mais aussi de pouvoir travailler hors des murs, de dépister les troubles mentaux, de les prévenir afin d’éviter la chronicisation et l’exclusion.
En 1952, avec l’arrivée des neuroleptiques, des conditions favorables semblent réunies qui permettent d’envisager réellement la mise en place du secteur :
- Des moyens financiers supplémentaires sont attribués.
- Une pensée plus libérale et une volonté thérapeutique animent les psychiatres qui entament un début de réforme des institutions.
- Des circulaires ministérielles accompagnent le projet et déterminent le caractère d’établissements de soins des hôpitaux psychiatriques. Entre 1949 et 1951, elles accordent la gratuité du placement volontaire et reconnaissent la nécessité de l’hospitalisation en service libre.
Mais malgré tout, l’activité extra hospitalière se résume bien souvent à quelques consultations dans des dispensaires encore en nombre insuffisant et sans lien direct avec les services d’hospitalisation. Le congrès de psychiatrie et de neurologie en 1959 à Tours, redéfinit les bases de la sectorisation. Les thèmes abordés sont la prévention, la prophylaxie, la cure et la post-cure.
On envisage, dans les quinze années à venir, la mise en place de structures diversifiées fonctionnant avec l’hôpital ouvert (1963) et les dispensaires : des centres d’urgences, des hôpitaux de jour et de nuit, des hospitalisations à domicile, des appartements thérapeutiques, des foyers de post-cure, des ateliers protégés, etc...
Le projet est élaboré en collaboration directe avec le Ministère de la Santé.
La circulaire du 15 Mars 1960, année mondiale de la Santé Mentale, représente l’acte de naissance administratif de la psychiatrie de secteur et sa mise en chantier :
Chaque département est découpé en territoires géographiques de 67 000 habitants placés sous la responsabilité d’une même équipe médico-sociale (médecin, psychologue, assistante sociale, infirmier et secrétaire).
L’objectif est d’assurer le dépistage précoce, le traitement avec ou sans hospitalisation et le suivi extérieur des malades mentaux.
La psychiatrie, sortant de l’hôpital, s’engage à aller au devant des pathologies, pour les prévenir et les traiter dans les lieux mêmes de leur éclosion, afin de séparer le moins possible le patient de son entourage.
Par ailleurs, il est convenu que chaque secteur devra comporter au minimum 200 lits d’hospitalisation.
Mais la réalisation de cette circulaire, par la suite, ne se fait qu’au ralenti.
En 1964, les DDASS (Directions Départementales de l’Action Sanitaire et Sociale) remplacent les CMM - les Commissions des Maladies Mentales, formées depuis 1949 par des médecins, des représentants syndicaux des personnels soignants et des membres de sociétés savantes - qui étaient à l’origine du projet de sectorisation. Les DDASS sont menées uniquement par des administratifs qui ignorent tout du secteur et ne soutiennent pas sa réalisation. Ce sont des gestionnaires et non pas des soignants.
Il faut attendre 1972 pour que reprennent les débats concernant la mise en place de la sectorisation. Mais cette fois-ci, elle se trouve assujettie à la loi hospitalière, votée deux ans auparavant, et qui instaure la « carte sanitaire », c’est à dire une planification des dépenses et des équipements par territoires déterminés.
En 1980, Simone Veil, ministre de la santé, fait le bilan des moyens mis en oeuvre dans le traitement des maladies mentales :
Il existe seulement 911 secteurs alors qu’il en avait été prévu 1200.
Une bonne centaine ont implanté leur service d’hospitalisation au sein d’un hôpital général.
Les unités de soins restent encombrées de malades chroniques et désocialisés, parce que les moyens financiers, déterminés par le nombre de journées d’hospitalisation payées par la Sécurité Sociale, imposent ce mode de fonctionnement. Si la durée de séjour diminue sensiblement, les entrées, par contre, ont doublé entre 1963 et 1978.
80% des dépenses en psychiatrie sont encore affectées à l’intra hospitalier.
Les DDASS gèrent les structures extérieures avec austérité, sans étude préalable des vrais besoins des populations. Les secteurs ne disposent pas tous d’un dispensaire et les alternatives à l’hospitalisation n’existent presque pas.
Le secteur se limite à être un territoire géographique où l’on recrute les malades et où on les accompagne lors des sorties et des promenades.
La véritable dimension de prévention, de conseil (prise en charge dans les écoles, dans les familles, etc...) et de suivi extérieur n’est pas abordée et ne le sera que difficilement par la suite.
En 1980, le gouvernement impose la nécessité de réduire les dépenses de santé. Et pour la psychiatrie, l’ère de prospérité est bien terminée, puisque l’on envisage la suppression de 40 000 lits. Les malades en trop sont contraints d’aller rejoindre les MAS (maisons d’accueil spécialisées) ou les services « longs séjours » qui fonctionnent avec un personnel réduit au maximum.
A partir de cette date, il n’y aura plus de création de poste en psychiatrie. Les nouvelles structures qui pourront être mises en place ne le seront que par des manoeuvres de redéploiement du personnel et des moyens financiers.
Le déficit de 350 millions de francs dans le budget de la psychiatrie extra hospitalière interdit de reparler du secteur. Des postes de médecins, de psychologues et d’infirmiers sont supprimés dans les dispensaires.
1983 est l’année d’adoption du Budget Global.
La maîtrise des dépenses de santé est dès lors assurée par l’augmentation du pouvoir des directeurs d’établissement, qui se fait au détriment de celui des médecins.
L’hôpital devient une entreprise avec son principal souci de rentabilité, de planification et d’évaluation des coûts par malade.
Sur les 40 000 lits que l’on avait prévu de supprimer, 12 000 le sont effectivement, tandis que l’on envisage pour les 28 000 restants, sans augmentation des budgets, une reconversion dans des structures alternatives. Celle-ci n’aura jamais lieu, par contre, les lits tomberont très vite dans le domaine privé.
Le 25 Juillet 1985, la loi concernant le secteur psychiatrique est finalement votée, dans un hémicycle presque vide.
La santé mentale n’intéresse plus personne. Cherchant surtout à faire la prévention des dépenses de l’Etat, cette loi confie la gestion et le financement des structures extérieures aux établissements hospitaliers qui sont eux-mêmes placés sous le régime de la Sécurité Sociale. C’est donc elle qui prend à sa charge le budget du secteur (prévention et soins ambulatoires) : 2 milliards et demi de francs.
Invoquant des impératifs budgétaires et des motifs économiques, l’Etat se désengage complètement.
Le 14 Mars 1990, une circulaire ministérielle relative aux orientations de la politique de santé mentale reparle vaguement de la nécessité de désinstitutionnaliser, de désaliéner, mais sans offrir de réels moyens de changement.
Il n’est plus question de prévention et de lutte contre l’exclusion.
On évoque aussi l’indispensable réforme de la loi de 1838. Celle du 27 Juin 1990 qui veut lui succéder n’est en réalité qu’un petit dépoussiérage. On se contente de changer quelques termes.
Le rapport Massé, en 1992, préconise l’intégration de la psychiatrie à l’hôpital général. Ce rattachement est présenté à la fois comme un moyen et comme une fin.
Certes, il est nécessaire de reconnaître que la souffrance psychique n’est pas réservée qu’à la psychiatrie et qu’elle s’exprime aussi dans les services de médecine. Il est regrettable d’ailleurs que l’on ait attendu si longtemps pour s’en rendre compte.
En outre, le rapport a le mérite de découvrir une autre obligation à la psychiatrie, celle de la prise en charge des populations marginalisées. Les murs des banlieues et ceux des prisons contiennent de plus en plus mal une folie bien aussi terrible que celle que l’on cache derrière les murs de l’asile.
Suite à cette prise de conscience sur les réalités de la souffrance psychique aujourd’hui, on s’imagine alors que le rapport va offrir les moyens de pratiquer une psychiatrie ouverte sur la cité.
En fait, il préconise d’englober les structures psychiatriques dans les hôpitaux généraux, sans entraîner une augmentation des dépenses de l’assurance maladie.
Ce retour à l’institution médico hospitalière, justifié par des restrictions budgétaires qui n’expliquent cependant pas toutes les résistances, laisse présager de l’avenir de la psychiatrie.
Le projet de sectorisation, né d’un traumatisme de l’histoire et d’une volonté de rupture avec l’exclusion, avait déterminé un vrai discours sur la folie dans sa dimension sociale.
Il s’efface maintenant devant un ordre administratif et médical qui conduit la psychiatrie à retrouver ses origines.
Les explications neurologiques, biologiques, génétiques vont pouvoir s’imposer à nouveau pour faire taire la folie dans le silence du médicament et de l’hôpital général.
3
LA CONTESTATION
Au moment où la psychiatrie entre dans une période mutation décisive, avec l’ouverture des asiles, l’utilisation des médicaments, les projets d’humanisation et de sectorisation, elle se trouve alors paradoxalement remise en cause par un grand mouvement de contestation générale.
Il se développe dans les années 60-70, concerne toute l’Europe et même les USA.
Les partisans de cette anti-psychiatrie dénoncent les abus d’internement, s’opposent à l’utilisation des médicaments et de toute forme de traitement, et surtout considèrent que les concepts de « maladie » et de « normalité » ne veulent rien dire. On retrouve dans leur discours une certaine « Éloge de la folie » assez proche de celle d’Erasme.
La contestation touche aussi la psychanalyse. Après avoir connu son heure de gloire, elle devient à son tour une institution en crise. On doute de son caractère scientifique et l’on parle volontiers d’une « supercherie » pour juger de son efficacité.
Elle représentait un espoir thérapeutique pour tous ceux qui, avec l’anxiété, la dépression, les difficultés d’adaptation, ont à supporter leur part de souffrance psychique sans être étiquetés « malades ».
Mais elle n’a pas réussi à s’adapter à cette nouvelle demande de soins et à prendre en charge le « mal de vivre » des gens « normaux ».
C’est pourquoi, très rapidement viennent lui succéder des « thérapies miracles », qui, s’inspirant de la psychanalyse, proposent des méthodes rapides, fertiles en émotions et efficaces au point de faire ressentir l’impression d’un mieux être immédiat.
-L’anti-psychiatrie : nouvelle Éloge de la folie :
Ce mouvement débute dans les années 60 et devient surtout actif en France après 1968. Il part d’Angleterre avec les psychiatres Laing et Cooper.
En Italie, c’est Basaglia qui s’en fait l’écho et qui inspire la Loi du 13 Mai 1978 portant sur la suppression des hôpitaux psychiatriques et l’abrogation de celle de 1904 sur l’internement.
Aux USA, Thomas Szasz reprend les mêmes théories, tandis qu’en France, Michel Foucault, Maud Mannoni et Roland Jaccard en sont les interprètes.
L’anti-psychiatrie, assez proche de certains discours politiques, est d’abord une critique de la société. Elle considère que la folie n’existe pas, qu’elle est un mythe, un langage, mais certainement pas une maladie. Elle accuse la société et surtout l’institution familiale de fabriquer l’aliénation en désignant comme « fou » celui qui dérange parce qu’il incarne la violence et le malaise de toute la collectivité. Reconnu dangereux, il se retrouve interné.
La distinction fou/non fou et malade/médecin est une aberration.
Les anti-psychiatres pensent que le fonctionnement de la psychiatrie représente une continuation de l’Inquisition.
Les fous sont persécutés dans les asiles, comme on persécutait autrefois les sorcières. Les malades sont tués avec des électrochocs, des lobotomies ou des camisoles chimiques. On a trouvé de nouveaux coupables pour expliquer les problèmes de la société. Les psychiatres ne sont que des menteurs, des criminels et des Inquisiteurs.
La folie, loin de traduire l’égarement d’un petit nombre, exprime les difficultés vécues par tous pour rester adaptés aux normes sociales. En ce sens, son langage a une certaine sagesse qui fait que le fou peut apprendre beaucoup aux autres. Son expérience est riche d’enseignement.
L’anti-psychiatrie reprend cette vieille image positive de la folie et son discours est assez proche de celui d’Erasme et de son « Eloge »:
« Est reconnu fou celui qui dérange ».
« La folie est relative, c’est la société qui en fixe les limites ».
« C’est une grande sagesse que de savoir être fou ».
Alors, on refuse les hôpitaux parce qu’ils engendrent la maladie et on accuse les psychiatres d’être plus fous que leurs patients quand ils s’entêtent à distribuer des drogues au nom d’une certaine « normalité ».
Des expériences de vie communautaire sont tentées, basées sur le principe que le meilleur traitement de la folie est de ne pas la soigner. Ainsi on doit laisser la schizophrénie évoluer d’elle-même,vers une « métanoïa », un « voyage au-delà de soi » salutaire et enrichissant. Les résultats, en général, s’avèrent très décevants.
Née du procès de la société aliénante, l’anti-psychiatrie s’éteint d’elle-même dans les années 80.
Mais ce mouvement de contestation est aussi parti du constat que, malgré l’ouverture de l’hôpital, les projets de sectorisation, l’aide apportée par les psychotropes et la psychothérapie, la maladie mentale existera toujours. Cet espoir thérapeutique auquel on avait cru quelques années auparavant est déçu. La psychiatrie ne guérit pas. Les troubles restent difficiles à étiqueter et à expliquer, le pronostic est toujours incertain et le traitement uniquement palliatif.
Devant ce constat d’échec, le discours réactionnaire de l’anti-psychiatrie s’est bâti d’autres illusions : il n’y a pas de malades mentaux mais seulement des gens ou des comportements qui dérangent l’ordre social établi et qui font l’objet d’une répression sous l’étiquette de traitements salutaires.
Malgré des aberrations évidentes, l’anti-psychiatrie a été un courant de pensée qui a stimulé largement le changement dans l’attitude sociale par rapport à la folie.
Finalement, on prend conscience que les thérapeutes de l’âme ne parviennent pas et ne parviendront jamais à conquérir l’esprit et à en maîtriser ses débordements. Le psychisme est cet endroit de rencontre et de communication de l’individu et de la société, mais il est aussi le point d’émergence de la folie qui s’inscrit d’emblée comme une rupture de cette communication.
Par conséquent, la maladie mentale réclame davantage une considération sociale que médicale puisque, participant à l’histoire de l’homme, elle représente avant tout cette difficulté de vie en société qui ne concerne pas uniquement le fou.
-La psychanalyse contestée :
Elle aussi, à son tour, se retrouve sur le banc des accusés pour n’avoir pas répondu à toutes les espérances que l’on en attendait.
Entrée en France en 1923, elle tarde à se faire une place. On ne compte en effet que 150 praticiens en 1950. Par contre, le succès qu’elle connaît ensuite lui permet d’en avoir 4000 dans les années 80. Le sommet de sa gloire semble alors être atteint car depuis une diminution importante et progressive du nombre des psychanalystes est enregistrée. Elle traduit le net désintérêt que l’on accorde désormais à ce procédé thérapeutique qui pourtant, à une certaine époque, représentait une idéologie dominante.
On reproche à la psychanalyse d’être trop chère, trop longue et de n’avoir jamais vraiment pu prouver son efficacité. De plus son côté intellectualisant ne lui permet de s’adresser, en définitive, qu’à un nombre limité de personnes.
On sait, par ailleurs, qu’elle reste inappropriée dans le domaine des psychoses et qu’elle n’est entrée à l’hôpital que dans la tête des soignants.
Sa théorie fait l’objet de sévères critiques qui soumettent la doctrine du maître à une rude épreuve :
-Le complexe d’Oedipe, que Freud considérait comme universel, semble être l’un des éléments le plus controversé de la construction psychanalytique.
En 1887, lors de son auto-analyse, Freud raconte qu’il a été amoureux de sa mère et jaloux de son père. Il utilise cet évènement marquant de sa jeunesse pour en faire la pierre angulaire de toute sa théorie. Selon lui, tous les petits enfants, entre trois et cinq ans,éprouvent les mêmes sentiments envers leurs parents.
Deux psychologues allemands des universités de Hanovre et de Heildeberg, se sont lancés dans une étude sur ce fameux complexe d’Oedipe. Ils démontrent que loin d’être un passage obligé dans la formation de la personnalité, il ne se manifeste presque jamais et reste, en définitive, une « pure invention » de Freud.
Sur 130 enfants, garçons et filles âgés de trois à neuf ans, on a constaté que:
81,5% jugent leur mère gentille et 78,5% jugent leur père gentil.
Aucun enfant n’idéalise le parent du sexe opposé et chacun s’identifie fortement au parent du même sexe que lui.
Si le complexe d’Oedipe apparaît quasiment invérifiable dans notre société, il devient par contre complètement caduque dans celles à filiation matrilinéaire.
Les contextes psycho sociaux et familiaux étant tellement différents selon les cultures, il semble bien que la psychanalyse ne puisse pas prétendre avoir une dimension universelle.
-La théorie freudienne reste aussi largement discutable sur un autre point essentiel : elle considère que le refoulement et la sexualité sont à l’origine de la plupart des maladies mentales.
Cette restriction trop simpliste ne tient pas compte de tous les facteurs socio environnementaux qui peuvent intervenir dans l’organisation psychique au cours de l’existence.
Les études ethnologiques nous prouvent que l’homme doit avant tout être compris comme un être historique, évoluant dans un milieu social et culturel qui détermine ses modes de pensée, de comportement et ses styles de conduite.
-Au sujet de la cure proprement dite, on est en droit aussi de s’interroger sur cette fameuse
« neutralité bienveillante » de l’analyste et sur la façon dont elle influence les aveux du patient.
Ce dernier est amené à se construire un monde mental qui correspond au cadre fourni par le thérapeute. Il s’agit d’une forme d’induction subliminale qui lui impose de n’apporter que des souvenirs et des émotions qui vont plaire à son analyste.
Le transfert est une histoire d’amour qui opère, on le sait, par la séduction.
L’objectivité du thérapeute reste à prouver et la véracité des confessions du patient aussi. N’est-t-il pas enclin à dire ce que l’on a envie qu’il dise et à croire ce que l’on a envie qu’il croit ?
Frank Sulloway, historien des sciences, du « Massachussett’s Institue of Technology », a réalisé une large étude sur la théorie freudienne.
Selon lui, pour s’assurer de l’avenir de la psychanalyse, Freud se serait inventé des succès thérapeutiques.
Anna O., une de ses patientes, n’aurait en fait jamais été guérie.
Preuves à l’appui, Sulloway avance que sur six patients déclarés « guéris » par Freud, un pris de dégoût aurait abandonné très tôt le traitement, deux n’auraient pas été réellement soignés par lui,tandis qu’un autre n’aurait jamais subit d’analyse.
Sulloway dénonce la supercherie de ces prétendues guérisons et explique que, de la même manière, tout l’édifice de la psychanalyse repose sur du vent.
-Les psychothérapies miracles :
La psychanalyse est devenue une institution en crise. Et son déclin est surtout manifeste dans les pays où elle s’était le plus répandue.
Mais de ses cendres à peine éteintes, sont nées rapidement de nombreuses thérapies qui veulent lui succéder.
Elles présentent des procédés thérapeutiques plus brefs et plus efficaces, partant du principe que ce n’est pas la remémoration des souvenirs inconscients qui guérit, mais plutôt leur reviviscence dans une relation fournissant une « expérience collective ».
Il s’agit de répondre à une demande qui s’oriente davantage vers des problèmes sociaux, des situations de crise, des difficultés relationnelles dans le travail, la famille ou la société.
Les conflits actuels et interpersonnels semblent mériter plus d’attention que les conflits internes anciens.
Il y a un gros aveu de souffrance psychique dans la société des gens « normaux » qui s’exprime par l’immense désir de se sentir bien adapté au groupe social, de s’y créer une appartenance sécurisante. C’est comme si l’on avait pris conscience que le danger de la maladie mentale, jamais écarté, provenait justement d’une mauvaise adaptation aux normes définies par ce groupe social.
Chacun vit dans l’incertitude cruelle de ne pas pouvoir préserver son équilibre psychique dans une société où la frontière entre le fou et le non fou, le pathologique et le normal est bien peu délimitée.
C’est ainsi qu’apparaissent, autour des années 50-60, principalement aux USA, quelques 200 techniques psychothérapiques brèves, individuelles ou collectives. Elles sont toutes plus ou moins issues de la psychanalyse qu’elles adaptent à la nouvelle demande.
On ne parle plus en termes de Moi, de Ca ou de Sur-Moi, mais en termes de Self (manière d’habiter son corps), d’Objet, de Narcissisme, de Communication.
Dans un premier temps, seuls médecins et psychologues sont habilités à pratiquer ces nouveaux traitements. Mais compte tenu de l’importance de la demande, il se forme très vite un « Syndicat National de Praticiens en Psychothérapie » qui propose de créer une profession de santé indépendante.
Et le marché, à peine lancé, laisse entrevoir déjà des bénéfices financiers aussi séduisants qu’encourageants.
C’est un véritable ouragan de psychologie « made in USA » qui déferle alors sur l’occident. Des milliers de spécialistes viennent prendre en charge lucrativement le « malaise social », la « souffrance existentielle ».
Ils offrent un assortiment varié de techniques pour analyser, disséquer, contrôler, renforcer ou immuniser l’individu désormais persuadé de souffrir d’un mal épouvantable : celui de vivre.
Ces méthodes garantissent un mieux être immédiat, une guérison symptomatique rapide, une amélioration des relations interpersonnelles, une meilleure tolérance aux tensions psychiques et à la frustration, une augmentation de la capacité d’aimer et tout un tas d’autres merveilles du même ordre.
Convaincus d’être malades ou de risquer de le devenir, les gens, au lieu d’aller transférer chez l’analyste, vont téter et vagir en thérapie primale, crier et s’époumoner dans les groupes Casriel, défoncer les matelas en bio-énergie, jouer avec « l’enfant qui est en soi » en analyse transactionnelle ou se mettre à poils dans les groupes de « rencontre et de ressenti ».
On a enfin trouvé des méthodes simples et efficaces pour vaincre le « mal de vivre », pour parvenir à s’ « aimer soi-même », à se rebâtir intérieurement, à fortifier sa personnalité.
La thérapie primale :
Elle a été créée par Arthur Janov, un philosophe recyclé dans la psychologie, à Los Angeles. Selon lui, il faut laisser s’exprimer et se libérer la douleur morale de l’individu.
La maladie mentale est due à une trop grande souffrance accumulée dans la prime enfance.
La thérapie vise à faire régresser les patients jusqu’à leur naissance, à recréer les scènes primales déterminantes. Le sujet doit ainsi se libérer de ses défenses pour retourner au « cri primal ». Le cri est une catharsis qui guérit.
Au cours du traitement , il n’est pas rare de voir des adultes vagir et téter comme des enfants, ou se tordre de douleur en hurlant :
« Maman, aime-moi » !
Janov prétend que l’on naît tous pareils, mais que c’est l’environnement parental qui fait de nous des névrosés ou des psychotiques.
Le groupe Casriel :
Casriel est un médecin qui a fondé son institut à Park Avenue à New York.
Sa thérapie utilise aussi le cri, mais en groupe.
Les patients sont réunis et chacun à leur tour, ils déversent toutes leurs angoisses : divorce, séparation, incapacité à être heureux en amour, insécurité, difficulté à se sentir bien dans sa peau, etc...
Ensuite, main dans la main, ils se disent les uns aux autres :
« Va te faire fouttre » !
La technique oscille entre l’accusation et le soutien affectif que l’on retrouve dans chaque groupe. Ils discutent, se plaignent, se consolent, pleurent, gesticulent, se disputent ou s’agressent, mais tout se termine heureusement par des embrassades et une réconciliation.
Le but de la technique, toujours identique, est de favoriser l’expression de la colère et de l’angoisse.
L’expérience affective du groupe permet à l’individu de retrouver une identité, une image sociale, d’expérimenter le rejet des autres, de se reconnaître et de se sentir heureux et accepté.
L’analyse transactionnelle :
Créée par le docteur Eric Berne aux USA, cette psychothérapie, qui se place parmi les moins onéreuses, connaît rapidement une grande popularité. Elle s’inspire de la psychanalyse pour en faire une cure à la portée de tous. Sa théorie est simple :
Dans chaque individu, il y a un Parent, un Adulte et un Enfant.
Ce sont les trois voix qui parlent en nous, les trois égos de notre personnalité.
Le Parent raisonne, approuve et gronde ; il évoque le Sur-moi freudien.
L’Adulte prend les décisions ; c’est un peu le Moi freudien.
L’Enfant est cette partie de nous-mêmes qui commande aux désirs, aux instincts, aux joies naïves et aux déceptions ; il est proche du Ca freudien.
Les gens réagissent et communiquent entre eux à travers ces trois cercles, c’est la Transaction.
Par exemple, un père en s’adressant à son fils peut très bien faire parler l’enfant qui est en lui et poser une question à l’adulte qui est en son fils.
Selon la théorie de l’analyse transactionnelle, l’enfant est un être vulnérable qui, dès sa naissance, est confronté à la réalité dure et angoissante du monde des adultes ; il contracte tout de suite le sentiment de « rien ne va pour moi » qui se traduira plus tard par une tendance à l’auto dépréciation, à la sous-estimation de soi, génératrice de décompensations pathologiques.
Le Parent est désigné coupable, car c’est lui qui communique le sentiment néfaste de « rien ne va », c’est lui qui contredit sans cesse l’Enfant qui est en nous, cette partie de nous-mêmes la plus vivante et la plus spontanée.
Et l’Enfant qui est en nous, découragé, déprimé, devient un souffre-douleur.
Ainsi est apportée l’explication au mal de vivre, au manque d’amour, à la maladie mentale.
Pour guérir, il faut restaurer le narcissisme, se rebâtir intérieurement. On peut transformer le sentiment de « rien ne va » en un « tout va bien pour moi » en retrouvant l’Enfant qui est en nous et en l’aimant.
L’analyse transactionnelle prône « l’amour de soi salvateur » qui permet d’acquérir l’ « Insight », la juste vision de soi et du monde.
La bio-énergie :
Alexandre Lowen, psychiatre et psychanalyste, a fondé l’école de la bio-énergie en 1954.
Sa théorie part de la constatation que l’individu, dans la société moderne, est toujours tendu psychologiquement et que cela transparait dans son attitude physique. Le corps se souvient autant que l’esprit, il garde en mémoire la trace des évènements passés, et, de ce fait, la rigidité corporelle trahit bien souvent des rigidité psychiques :
« Chacun de nos traits corporels trouve son origine dans des expériences infantiles ».
En bio-énergie, on apprend à vivre avec son corps, à le ressentir et à lui permettre de s’exprimer : boxer un divan, se battre avec des polochons, crier des insultes, etc...
Dans le défoulement, un transfert s’effectue. Les objets que l’on frappe, que l’on maltraite ou que l’on insulte sont personnalisés.
Cette thérapie provoque une crise émotionnelle curative durant laquelle l’angoisse est agie et évacuée.
La gestalt-thérapie :
Elle a été élaborée dans les années 40 par l’allemand Fritz Perls.
Selon lui, les troubles psychiques surviennent chez des individus dont la formation de la personnalité n’est pas terminée.
Pour guérir, le patient doit pouvoir retrouver son « soi », son unité intérieure, en exprimant au sein d’un groupe thérapeutique, tous ses conflits personnels qui font blocage.
Il s’agit d’un psychodrame où le sujet est amené à mimer les différents personnages qui l’habitent, jusqu’au moment où une décharge émotionnelle lui permet de compléter sa Gestalt, sa structure interne.
Cette thérapie a connu un immense succès aux USA et ensuite en France à partir de 1960.
La relaxation :
Cette méthode vise, grâce à une technique particulière, à instaurer un état de détente physiologique propice à réduire le stress et l’anxiété. Comme la plupart de toutes ces thérapies apparues à la même époque, elle se base sur le principe que c’est le corps qui peut agir sur le mental et non l’inverse.
Il existe différentes sortes de relaxation. Certaines sont assez élaborées comme le « Training autogène » créé par le psychiatre allemand JH Schultz en 1932 :
Le patient doit parvenir, avec l’aide du thérapeute, à se concentrer mentalement sur les sensations internes de son corps (pesanteur, chaleur, battements cardiaques, etc...) avant d’effectuer des exercices d’assouplissements et de respiration.
La détente ainsi produite est ressemblante à un état de conscience très proche de l’hypnose.
Les thérapies comportementales :
Très primées chez les anglo-saxons à une certaine époque, ces psychothérapies sont destinées à aider un individu malade à combattre ses difficultés comportementales en supprimant ou en inhibant ses symptômes, ses mauvaises attitudes, ses mauvais réflexes par des méthodes de conditionnement ou de déconditionnement.
Alors que l’hôpital commence à s’ouvrir sur l’extérieur, au même moment, les gens « normaux » revendiquent eux aussi le droit de souffrir de troubles mentaux et d’être pris en charge.
Un marché prometteur s’ouvre pour de nouveaux psychothérapeutes, quelques fois psychiatres, psychanalystes ou psychologues reconvertis, qui remportent un succès aussi immédiat qu’éphémère.
Dans ces groupes de traitement, ils retrouvent un peu l’influence du sorcier guérisseur sur la tribu ou du magnétiseur sur les hystériques. La magie reprend sa place.
Les patients ressemblent à ces anciens convulsionnaires qui espèrent, en vivant une expérience émotionnelle paroxystique, être miraculeusement guéris et vaccinés à tout jamais contre le mal de vivre, l’angoisse, la dépression et toutes les vicissitudes de l’existence moderne qui font rôder le danger de la folie à la porte de chacun.
Ils se présentent en thérapie avec un besoin d’amour et de reconnaissance insatisfait et une incapacité à assumer leur propre vie.
Leurs défenses sont fragiles et leur seuil de tolérance à la frustration très bas. Au moindre échec, ils souffrent immédiatement d’un profond malaise émotionnel qui laisse craindre une décompensation pathologique.
L’aveu d’une telle souffrance psychique dans la société des gens normaux sème le doute : qui est malade, qui ne l’est pas ?
Le concept de normalité admis jusqu’alors mérite une révision.
On considère comme « normal » celui qui reste adapté à son milieu même s’il souffre de troubles psychiques importants et que le milieu en question est nocif. Sa pathologie n’est reconnue que lorsqu’il est rejeté par les autres. C’est pourquoi au terme de normal on préfère celui de « bien portant » qui, malgré une pathologie parfois marquée, reste adapté à une pseudo normalité.
Une fois passée la mode des psychothérapies miracles, c’est à la psychiatrie qu’il incombe de prendre en charge ce malaise de la société qui conduit de plus en plus de gens à la dépression, à l’exclusion, à la psychopathie, à la sur consommation de médicaments ou au suicide. Mais désormais, il apparaît difficile de s’appuyer sur une psychologie qui, ayant tellement souffert d’être dévoyée, dénaturée, vulgarisée, a perdu de son sens et de sa valeur.
Le soin va maintenant devoir obéir à des raisonnements plus matérialistes et se rationaliser dans une médicalisation.
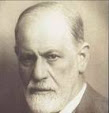
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire