
XX e SIECLE : 3 e PARTIE
1
LE RETOUR AU RATIONALISME
Actuellement, la science redevient l’idéologie dominante. C’est elle et uniquement elle qui doit assurer le bonheur de l’être humain. Elle mérite par conséquent, qu’on lui accorde toute notre confiance.
La réflexion philosophique, à côté, parait bien dérisoire et semble n’intéresser plus personne. Quant à la psychologie, elle est abandonnée pour n’avoir pas fait ses preuves.
Pourquoi irait-on encore se préoccuper de cette âme que la biologie moléculaire n’a pas trouvée ? Le discours scientifique n’a pas de temps à perdre à s’embarrasser de cet accessoire inutile.
Le scanner, l’IRM ou la tomographie à émission de positrons ont l’intention de nous en apprendre bien davantage sur le cerveau et les mécanismes de la pensée que ne l’ont fait, en leur temps, la philosophie, la psychologie ou la psychanalyse.
Ainsi, c’est tout à fait scientifiquement que la maladie mentale redevient cette maladie du système nerveux . Et la psychiatrie, pour échapper à ses incertitudes, renoue sagement avec ses origines neurologiques : la médecine classique lui apporte les méthodes de diagnostic et de traitement qui feront d’elle, définitivement , une science exacte. La folie, comme toute pathologie, réclame une explication rationnelle qui ne peut être recherchée que dans une anomalie du fonctionnement cérébral.
A l’aide d’instruments modernes d’exploration, on va s’efforcer de mettre en évidence les facteurs responsables, convaincu de trouver la logique de l’insensé dans une excuse organique. Et à défaut de pouvoir réellement comprendre ce qu’est la folie, au moins saura-t-on d’où elle vient, parce que cette énigme, à la longue, est insupportable.
-La recherche des causes organiques :
Les facteurs biochimiques :
La biologie moléculaire, ces dernières années, a énormément progressé dans l’étude portant sur les récepteurs cérébraux. Et, confortée par ses nouvelles connaissances, elle se porte charitablement au secours de la psychiatrie.
Experte dans l’art de décortiquer l’alchimie du cerveau, elle pense être capable d’expliquer la genèse des émotions, des affects, des idées et le pourquoi de leur dysfonctionnement.
Après avoir répertorié un nombre considérable de substances chimiques - ces porte paroles de l’information neuronale qui semblent agir sur le système nerveux central - la biochimie en conclut que la pensée normale comme la pensée folle doivent obéir à une logique et se traduire par des processus physiologiques mesurables.
La solution pourrait donc se trouver du côté des neuromédiateurs :
La sérotonine :
C’est la bile noire de notre époque. Depuis Hippocrate, elle est l’objet de bien des hypothèses en psychiatrie.
On sait qu’elle est en cause dans la dépression, lors de phénomènes hallucinatoires ou de conduites agressives et que son taux de concentration est sensible à la prise de LSD ou d’héroïne.
L’acétylcholine :
Un rôle lui est accordé dans la dépression et la schizophrénie, mais rien de formel n’a été découvert.
La dopamine :
Elle commande le tonus psychique et moteur, les sensations de plaisir et les émotions. Le manque de dopamine peut se manifester, entre autre, par la maladie de Parkinson, tandis que l’excès aurait pour conséquence une perte d’énergie et l’apparition de troubles autistiques.
On a constaté d’ailleurs que les amphétamines et la L Dopa (médicament anti parkinsonien), en activant les récepteurs dopaminergiques, peuvent parfois induire des états psychotiques.
Le stress semblerait aussi augmenter le métabolisme de la dopamine.
La noradrénaline :
Elle commande l’éveil, les prises de décision. Un défaut en noradrénaline serait peut être responsable d’une incapacité à éprouver du plaisir et des émotions.
Le Gaba :
C’est un acide aminé neurotransmetteur qui conditionne le niveau d’anxiété. Il est la cible privilégiée des tranquillisants.
Les endorphines :
Ce sont des morphines internes intervenant dans la régulation de la perception de la douleur et du stress. L’héroïne, par exemple, agit sur les endorphines.
La liste de ces neurotransmetteurs est très longue, il faudrait y rajouter la glycine, la taurine, des polypeptides, etc...
On a commencé à les identifier en 1952, lors des débuts prometteurs de la psychopharmacologie. On pensait avoir enfin trouvé un moyen de maîtriser totalement la folie en agissant sur ces récepteurs à l’aide de médicaments.
Mais par la suite, les années d’expérience ont manifestement rendu compte du caractère utopique d’une telle ambition.
Si les molécules chimiques sont capables de provoquer des états artificiels de psychose, elles ne parviennent par contre que difficilement à stabiliser la maladie quand elle est installée et jamais à la guérir.
Avec l’actuelle tomographie à émission de positrons, il est possible de mesurer les modifications engendrées dans la chimie cérébrale par l’action des médicaments. Et les résultats, apparemment, ne semblent pas prouver qu’il existe une logique organique rigoureuse dans l’effet des produits administrés.
Effectivement, si certaines études démontrent par exemple que la Chlorpromazine et l’Halopéridol ralentissent ou bloquent le taux de dopamine, d’autres indiquent que la Chlorpromazine peut aussi avoir parfois des effets sur les taux d’adrénaline et de sérotonine.
De la même façon, il apparaît que pour une psychose donnée, suivant le patient, l’interprétation des manifestations chimiques puisse être différente.
Pendant longtemps, on a établit avec certitude une corrélation entre l’hyperactivité des récepteurs dopaminergiques et la manifestation des symptômes schizophréniques. Or, des études plus récentes amènent à penser que la schizophrénie n’agirait pas sur les récepteurs dopaminergiques ou sérotoninergiques, mais sur d’autres neurotransmetteurs (acides aminés ou récepteur sigma).
Ce que l’on peut constater et qui n’est pas trop sujet à controverses, c’est que la psychose, en général, se traduit par une augmentation du taux de « bile noire »ou sérotonine, ce qui explique la survenue de symptômes déficitaires allant dans le sens de la chronicisation, et par une augmentation des endorphines, ce qui explique la résistance parfois étrange de certains psychotiques à la douleur. En tout cas, il est impossible d’affirmer d’une façon précise que les maladies mentales ont, pour origine, une altération du fonctionnement des neuromédiateurs.
Est-ce que les perturbations chimiques enregistrées sont la cause ou l’effet de la maladie ? Cette question reste toujours posée... malgré les réponses déjà apportées auparavant. (cf Jung p. 85)
Aujourd’hui, même avec la tomographie, on ne dispose encore que de peu d’éclaircissements quant à l’origine neurochimique de la folie et à l’impact réel des médicaments sur le fonctionnement mental.
C’est d’ailleurs avec regret que l’on se rend compte que les neuroleptiques ne répondent pas toujours aux espérances souhaitées.
En effet, sur certains malades, sans que l’on sache pourquoi, ils semblent quelques fois ne pas avoir d’action.
Les études sur la biochimie du cerveau n’apportent pas de preuves irréfutables ou d’explications satisfaisantes sur la genèse de la folie. Mais la recherche des causes organiques n’en est pas terminée pour autant.
Les facteurs héréditaires :
Depuis les théories de Morel et de Magnan sur l’hérédité et la dégénérescence, au XIX e siècle, d’autres hypothèses ont été avancées dans ce domaine, notamment celles sur les constitutions mentales de Dupré et Delmas ou les constitutions morphologiques de Kretschmer.
L’eugénisme, l’utilitarisme social ont trouvé et trouveront toujours des adeptes à tous les moments de l’histoire, surtout dans les périodes où l’explication psychologique fait défaut.
Actuellement, on espère encore, grâce aux découvertes récentes sur l’hérédité, pouvoir parvenir à prouver que la folie obéit à un déterminisme génétique.
C’est ainsi que l’on retrouve les notions de transmissions, de patrimoine, de tare ou d’atavisme. On part à la recherche de l’empreinte, de l’étiologie, de l’explication dans l’héritage familial.
Ce serait un bon moyen, pour se débarrasser enfin de la psychiatrie, que de réussir à apparenter la folie à une maladie héréditaire.
Les recherches génétiques ont surtout concerné la schizophrénie, et ont débouché sur des polémiques intarissables et des hypothèses parfois tout à fait farfelues.
On sait que le risque, dans la population ordinaire, de développer une telle pathologie, se situe à environ 1%, ce qui correspond à peu près à 550 000 personnes en France.
Ce risque est multiplié par 10 pour les enfants dont un des parents est atteint de schizophrénie, et par 30, si les parents le sont tous les deux.
Pour deux jumeaux monozygotes, si l’un est schizophrène, son frère, même élevé par d’autres parents, souffrira de cette maladie dans 40% des cas.
Si les jumeaux sont dizygotes, ce risque est ramené à 10%.
L’influence héréditaire parait donc indiscutable, mais on est encore loin de pouvoir attribuer la transmission au seul facteur génétique.
L’éclosion de la schizophrénie semblerait mettre en cause plusieurs gènes dont on ignore la localisation, le nombre et la combinaison. Aucune preuve formelle n’a encore été apportée, la part héréditaire ne dépendant pas, comme pour la chorée ou la maladie d’Alzheimer, d’un seul gène. Néanmoins, certaines thèses n’hésitent pas à évaluer le taux de responsabilité génétique, dans la survenue de cette psychose, aux alentours de 60 et même 80%.
On a aussi envisagé l’hypothèse d’une corrélation possible entre la schizophrénie et les chromosomes 11 et 5.
De la même façon, on a présumé qu’un groupe sanguin particulier, type HLA, avec ses gènes localisés sur le chromosome 6, aurait quelques affinités avec la maladie.
En détectant les gènes de susceptibilité dans le domaine de la folie, on établirait une égalité entre les symptômes et les caractéristiques génétiques qui permettrait de ranger la maladie mentale parmi les maladies organiques et de la traiter avec des méthodes classiques et rationnelles.
Mais la réalité n’est pas celle-ci, la folie continue d’apporter ses contradictions et ses paradoxes. Ainsi, un porteur de gène pathologique peut rester « bien portant » toute sa vie, un individu présentant une personnalité pré psychotique ne jamais déclarer la maladie, tandis qu’un autre, sans signe prémonitoire, sans excuse organique, verra sa santé mentale se dégrader.
Les facteurs viraux :
Ayant constaté que certaines encéphalopathies pouvaient se traduire par des symptômes psychotiques, comme l’encéphalite léthargique ou celle provoquée par le virus du sida, on a imaginé qu’il devait être possible d’expliquer aussi la folie par un virus.
Une fréquence plus élevée de naissance de futurs schizophrènes en fin d’hiver a permis d’émettre l’hypothèse séduisante selon laquelle les infections virales de la mère au cours de la grossesse, et notamment par la grippe, pourraient être en cause. Rapidement, des statistiques ont démontré qu’il naît plus de schizophrènes dans les pays nordiques qu’en Océanie, où la grippe est presque inconnue. Les chiffres ont parlé, sans prendre en compte les facteurs climatiques et socioculturels, pour établir le rapport entre la pathologie infectieuse et la schizophrénie.
On a même retrouvé des traces de lésions virales dans le cerveau de schizophrènes décédés et, dans leur sang, la présence d’anticorps spécifiques, tels les cytomégalovirus.
Un grand nombre de facteurs biologiques, chimiques, génétiques, viraux semblent vouloir être retenus pour fournir une explication à la folie. Le domaine de recherche est vaste et les partisans de l’organogenèse sont encore loin de l’avoir épuisé.
La liste pourrait s’allonger à l’infini, comme au XVIII e siècle, lorsque l’on invoquait la colère des nourrices, l’influence de la lune, les fruits d’automne pas mûrs ou le retour des saisons... Les termes ont changé, aujourd’hui, on parle de virus, de chromosomes, de neuromédiateurs, de groupes sanguins.
Mais incriminer un virus ou la colère des nourrices relève de la même stupidité. C’est considérer un seul élément pour expliquer le tout.
Cet état d’esprit est, hélas, celui qui préside aux recherches actuelles, scientifiquement menées par les méthodes de la médecine classique qui consistent à découper les individus en morceaux pour soigner chaque morceau indépendamment des autres.
Tous les facteurs organiques qui ont été énumérés ne représentent en fait qu’une petite partie de toutes les nuances et les variations de la psychose. Ils n’auront jamais autant d’importance dans l’apparition de la maladie, que peuvent en avoir la sensibilité du patient, son affectivité et l’histoire de sa constitution psychologique.
-Vers une psychiatrie de laboratoire :
La recherche des causes organiques de la folie n’est pas un fait nouveau. D’ailleurs toute l’histoire de la psychiatrie s’est déroulée autour de ce dilemme : Que faut-il privilégier dans l’approche de la maladie mentale, la pathologie de l’organique ou celle du psychologique ?
On s’aperçoit que, très souvent, l’incertitude liée à des périodes socio économiques de crise et d’insécurité conduit à l’abandon du psychologique pour régresser vers des explications plus matérialistes et donc plus rassurantes.
Après la deuxième guerre mondiale, lorsque la psychiatrie, sortant alors de son exclusion, essaye de s’affirmer comme une discipline autonome, l’INSERM lui rédige une rubrique spéciale portant sur la classification des troubles psychiques.
Enfin sont nettement différenciés les troubles mentaux dés à une atteinte organique, de ceux, plus précisément psychiatriques, relevant d’une cause psychologique.
La folie est reconnue comme une maladie à part entière.
Cette nouvelle classification concrétise la place que la psychiatrie a désormais l’intention de revendiquer au sein de la médecine : elle se veut une spécialité traitant de la « psychogenèse », de la « causalité morale » des maladies mentales.
Ensuite, au fur et à mesure qu’elle s’émancipe, influencée par la psychanalyse, la psychiatrie renouvelle sa confiance au psychologique.
On s’éloigne volontairement des théories organiques et de la pure énumération des symptômes pour s’intéresser surtout, par une approche dynamique, à l’histoire du patient, à sa vie intérieure qui semblent, elles seules, contenir le sens et l’étiologie de la maladie.
Du DSM I au DSM III :
Outre atlantique, de son côté, l’Association Américaine de Psychiatrie, dès 1952, rédige sa propre classification des troubles mentaux, qu’elle présente dans un livre, le DSM I ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Discorders) .
D’inspiration nettement psychanalytique, il se détourne lui aussi des vieilles conceptions organiques de la folie.
Il Établit 106 catégories diagnostiques.
En 1968, la parution du DSM II porte ce nombre à 182.
Cet élargissement s’explique par le fait que les psychiatres ont alors à prendre en charge, non seulement les psychoses graves que l’on trouve à l’hôpital, mais aussi toutes les pathologies dépressives qui constituent l’essentiel de la clientèle de ville.
Comme celles de l’INSERM, les classifications du DSM II accordent une place de choix aux causes et aux traitements psychologiques des maladies mentales.
Par contre, dès 1970, on assiste à un changement fondamental d’orientation de la psychiatrie, lié à l’apparition des Associations Américaines de Neurochimie. Une nouvelle exigence s’impose, qui deviendra très vite internationale. Elle est scientifique : on reproche au DSM de ne pas être un « outil fiable de diagnostic ».
Le film « Shock Corridor », sorti en 1963 avait déjà dénoncé la possibilité d’internement abusif et d’erreur dans l’identification de la schizophrénie.
L’expérience de David Rosenham, en 1973, remet elle aussi en question la fiabilité du diagnostic en psychiatrie :
8 faux malades parviennent à se faire interner en hôpital en simulant des symptômes schizophréniques. Une fois hospitalisés, ils agissent normalement et ne présentent plus aucun délire ni aucune hallucination.
Tous reçoivent le même diagnostic : « schizophrénie en voie de Rémission ».
Ils sont relâchés au bout de 7 à 52 jours.
Cette expérience sème le doute : il est possible de prendre quelqu’un de normal pour un fou !
Apparemment, c’est la façon d’établir le diagnostic qui n’est pas bonne. A-t-on fait trop confiance au psychologique ?
On en conclut que pour juger de la santé mentale, il est nécessaire de s’appuyer sur un système de pensée plus matérialiste, plus médical, offrant la sécurité d’un raisonnement scientifique.
Les laboratoires de neurochimie vont savoir répondre à cette exigence et proposer une nouvelle méthode diagnostique qui sera à l’origine de la parution du DSM III en 1980.
Cette Édition n’a plus rien à voir avec les précédentes. Le nombre de catégories diagnostiques est porté à 265, dans un livre qui totalise 535 pages. Heureusement pour les utilisateurs, on a prévu, comme pour le Malleus Malleficarum, un modèle de poche.
Les laboratoires utilisent des méthodes qui ont fait leur preuve en médecine, pour démontrer l’efficacité du médicament : ce sont les statistiques et la comparaison avec le placébo.
Seulement, elles exigent de sélectionner des groupes de malades présentant exactement les mêmes symptômes.
Alors qu’en psychiatrie, on sait pertinemment qu’il est impossible de trouver des « causes », des « marqueurs spécifiques » et qu’aucun examen de laboratoire ne permet d’objectiver les pathologies, malgré tout, il faut absolument pouvoir former des groupes homogènes de patients ayant les mêmes troubles mentaux, disposer d’ensembles de cas comparables afin d’expérimenter scientifiquement les traitements médicamenteux.
La neurochimie, pour assurer son essor économique, oriente ainsi le DSM vers de nouvelles classifications diagnostiques et même vers une réforme complète de la clinique.
L’histoire du malade, la psychopathologie, le sens de sa maladie, l’influence des contextes socio environnementaux, relégués à l’arrière plan, cèdent la place à une uniformisation des pathologies, à un système diagnostic clair, net et précis.
Seule compte l’énumération des symptômes, individualisés et codifiés.
Le DSM III propose aussi une technique d’interrogatoires structurés, des règles standards de diagnostic et des schémas thérapeutiques bien définis. Ainsi, d’un médecin à un autre, et même d’un pays à un autre, les méthodes employées sont identiques.
La psychiatrie s’éloigne des conceptions philosophiques, psychologiques et sociologiques pour obéir au modèle médical strict. Elle devient une psychiatrie de laboratoire où la maladie mentale apparaît de plus en plus comme relevant de la médecine organique.
La puissance financière de l’Association Américaine de Psychiatrie, qui regroupe plus de la moitié des psychiatres du monde, a imposé les classifications du DSM III à toute la planète.
Chaque praticien a maintenant à sa disposition cette bible, cette panoplie de diagnostics et de traitements tout prêts rédigés dans un langage universel. Et même l’OMS s’y est accordée puisque son CIM (Classification internationale des maladies mentales) en est une copie conforme.
Toutes les manifestations de la folie sont répertoriées dans une longue liste bien ordonnée. On y trouve tous les signes qui permettent d’identifier la maladie et d’établir clairement la frontière entre le normal et le pathologique.
Le patient, numéro statistique, représente un symptôme, parce que c’est beaucoup plus facile et rassurant de soigner le symptôme que le patient. Et, du même coup, on replace ainsi la barrière sécurisante entre le soignant et le soigné.
Si le Malleus Maleficarum désignait avec certitude les sorcières et les hérétiques, le DSM III donne tous les signes, grâce auxquels, sans erreur, on peut reconnaître le fou.
La redéfinition des troubles mentaux :
Avec la parution du DSM IV en 1992 et prochainement celle du DSM V, on continue de s’acheminer vers une redéfinition complète des troubles mentaux. La liste des symptômes s’allonge encore pour justifier toujours plus de prescriptions médicamenteuses. Il y a surtout une urgence de distribution et de vente, plutôt qu’un réel besoin de soigner.
La schizophrénie qui, en 1952, se caractérisait cliniquement par la dissociation psychique, le délire et les hallucinations, devient aujourd’hui un ensemble de symptômes dispersés sur de nombreuses pages. On ne doit d’ailleurs plus dire un « schizophrène », mais un « individu présentant des troubles schizophréniques ».
La dépression autrefois nommée neurasthénie ou psychasthénie, voit son concept éclater en « dépression brève », « dépression récurrente », « dépression anxieuse », « dépression d’épuisement », « dépression hostile », « dépression masquée », etc... Les mots malade et affection ne sont plus utilisés. La névrose et l’hystérie en particulier ont disparu. Elles sont remplacées par une foule de symptômes auxquels correspondent une prescription.
Une nouvelle psychopathologie est crée, dominée par le souci de rester absolument symptomatique, a théorique et politiquement correcte.
L’homosexualité, comme toutes les conduites politiques, religieuses ou sexuelles déviantes ne sont pas admises dans le DSM et s’écartent de la responsabilité psychiatrique. Ainsi, les psychopathes, les pervers, les pédophiles ne peuvent pas être considérés comme des malades, de même que les fanatiques des sectes ou des mouvements extrémistes religieux.
La folie n’a plus rien à voir avec le social ou le politique.
Les conflits entre individu et société ne doivent en aucun cas se traduire par une quelconque souffrance psychique.
En outre, le DSM, qui a imposé ses définitions, ses concepts et ses classifications, n’imagine pas que sur terre il puisse exister des groupes ethniques de culture différente, bien entendu, de celle américaine.
Le congrès de psychiatrie qui a eu lieu à Madrid en Août1996 a adopté ce slogan universel :
« One world - one langage ».
La folie est donc partout la même, elle a une image uniforme.
Avec le DSM, le rêve des rationalistes des siècles passés est réalisé : on est enfin parvenu à enfermer la maladie mentale dans une classification, à cerner définitivement ce que l’on entend par folie, à mettre de l’ordre dans ce qui, justement, représente le désordre.
Ainsi, on peut maintenant soigner le psychisme et sa souffrance, ce qu’il y a de plus inquantifiable et subjectif, ce qu’il y a de plus spécifique à l’être humain, sa vie intérieure, avec un instrument de mesure et de traitement parfaitement clinique et scientifique.
Le médecin est capable d’établir un diagnostic infaillible, sans se baser sur son intuition ou son expérience et sans avoir une connaissance approfondie du malade.
Ainsi, même un praticien ordinaire, sans formation spécifique, peut rapidement devenir un excellent psychiatre, puisque la folie obéit au modèle médical uniquement et que les symptômes subjectifs se sont changés en symptômes objectifs adaptés à un traitement.
En disposant de critères diagnostiques et d’échelles de comportement pour juger de la folie et de l’asocialité, on peut quantifier, mesurer et traiter. La folie se rationalise, les malades deviennent des chiffres, des codes, des statistiques, des scores.
Dans la réalité, les soignants, jusqu’à présent, ont su conserver une certaine indépendance par rapport à ces nouvelles définitions, comme ils en avaient déjà par rapport aux anciennes, et ce système diagnostic traitement n’est heureusement pas appliqué à la lettre. Malgré tout, il représente un danger pour l’avenir : la psychiatrie semble échapper de plus en plus à ses soignants. Une volonté s’affirme chaque jour davantage de réduire le pouvoir du médecin, de dissimuler le discours de l’infirmier, sa liberté d’action et sa relation avec le patient derrière un respect des rôles, des protocoles, des diagnostics et d’une médicalisation. Avant d’être thérapeutiques, ces exigences sont surtout administratives et financières.
La philosophie de la folie, le « traitement moral », la psychothérapie résistent de plus en plus mal à cette arithmétique qui veut soigner la maladie mentale en multipliant les profits des firmes pharmaceutiques tout en réduisant les dépenses de ces nouvelles entreprises que l’on appelle hôpitaux.
-La nécessité de traiter :
Le soin n’appartient plus seulement aux soignants. D’ailleurs, il ne se donne plus, il s’administre, c’est à dire il se calcule en coût, en prix de journée et doit absolument se matérialiser par des actes quantifiables et informatisables.
Cette rigueur administrative est aussi à l’origine de la médicalisation actuelle de la folie. Nos gestionnaires ont davantage d’affinité avec la logique médicale classique qu’avec la psychologie et conduisent peu à peu la psychiatrie à perdre sa particularité.
Ainsi s’explique ce retour aux références biologiques et neuronales pour parler des problèmes de souffrance psychique et cette nécessité qui s’impose de rationaliser et de normaliser.
On multiplie les examens, les bilans sanguins ou radiologiques, suspectant une corrélation éventuelle entre les symptômes psychopathologiques et les index biologiques. On imagine toujours pouvoir mettre en évidence un dysfonctionnement du système nerveux central à l’origine des perturbations du comportement ou de la pensée.
Un tel raisonnement matérialiste réduit le cerveau à n’être qu’un simple organe, semblable aux autres, et dont les troubles « mécaniques et organiques » doivent être traités par le psychotrope, comme on traite l’infection par l’antibiotique.
Mais si rassurante soit-elle, cette médicalisation de la maladie mentale n’aboutit pas à des résultats satisfaisants :
-D’abord parce que la souffrance psychique ne peut pas être assimilée à un trouble organique ou mécanique. Intangible et subjective, elle reste quelque chose de proprement humain, qui a toute la signification que lui attribue celui qui en est atteint et qui la mentalise, et ceux qui en sont les témoins. Son expression varie d’un sujet à un autre, de sorte qu’il est impossible de rencontrer deux patients présentant les mêmes manifestations de la psychose.
Par conséquent, il semble insensé de vouloir établir un modèle général, des exemples types, ou de tenter d’uniformiser les troubles et les traitements.
-Ensuite parce que la disparition du symptôme, synonyme, bien à tort, de guérison en médecine, ne signifie pas en psychiatrie, que la maladie est vaincue. Dans le meilleur des cas, le psychotrope apporte un soulagement de la souffrance, une atténuation des délires et de l’agitation, qui permettent au patient de dépasser la période de crise et de retrouver la possibilité de communiquer.
C’est à partir de ce moment-là seulement, que la notion de soin prend son sens en psychiatrie, lorsque l’on accède à une réelle prise en charge du malade et à une meilleure connaissance de sa maladie.
Le traitement médical n’est donc pas un but, mais une étape seulement. Son choix est souvent empirique, il dépend de l’expérience et de l’intuition des soignants beaucoup plus que d’un quelconque schéma thérapeutique préétabli. On doit toujours l’adapter, le réviser, car chaque patient est un cas particulier aussi bien dans l’expression de sa souffrance que dans sa réceptivité et sa tolérance aux médicaments.
Loin d’être un produit magique, le psychotrope a un pouvoir limité sur la maladie et son utilisation peut présenter des risques de toxicité.
Les anti-dépresseurs entraînent une sècheresse de la bouche, de l’insomnie, de la constipation, des troubles cardiaques, une perte du désir sexuel et parfois une inversion rapide de l’humeur avec risque de suicide.
Les tranquillisants et les hypnotiques ont une forte action sédative.
Ils diminuent la vigilance, donnent des troubles de la mémoire, une fatigue, une impression d’ébriété et des phénomènes de dépendance.
L’administration de neuroleptiques, nécessaire en cas de psychose aigue ou chronique ou d’état d’agitation, provoque l’apparition de troubles secondaires tels qu’un abrutissement et une indifférence psycho affective pouvant à la longue, accentuer le côté déficitaire de la maladie et favoriser son évolution vers la chronicité.
En outre, certains malades semblent développer une résistance à l’action du médicament, et ne présenter jamais aucune amélioration .
Le psychotrope peut apporter une aide précieuse pour diminuer la souffrance psychique, mais c’est un médicament spécifique qui doit être prescrit avec beaucoup de prudence et de surveillance.
Les traitements psychiatriques ne peuvent donc pas être assimilés aux traitements classiques, de même que les maladies mentales ne peuvent pas être comparées aux autres maladies.
Malgré tout, le psychotrope n’est pas resté longtemps le médicament spécifique de l’hôpital psychiatrique. Très rapidement, son emploi s’est vulgarisé à l’extérieur des murs.
Les laboratoires pharmaceutiques sont responsables eux aussi de cette médicalisation de la souffrance psychique.
Le chimiste ne fréquente pas les établissements de soins, il ne s’intéresse pas au malade, mais seulement au symptôme. C’est un mécaniciste qui se contente de soigner l’organique, le biologique. Pour lui, le fou est resté cette « mécanique neuronale qui a des ratés » et la folie cette « maladie des organes du cerveau » qui, comme le symptôme en médecine, doit être soumise à un traitement pour la faire disparaître.
Il peut démontrer facilement que c’est le gène du récepteur D2 qui est en cause dans l’alcoolisme, qu’il y a une anomalie du fonctionnement des récepteurs sérotoninergiques à l’origine de la dépression et de l’anxiété et que la psychose maniaco-dépressive est une maladie génétique.
Mais le chimiste est avant tout un commercial, préoccupé d’assurer un chiffre d’affaire à sa firme. Il cherche à vendre des molécules. Et il a compris les intérêts financiers que représentent toutes les médications possibles de la souffrance psychique.
Le psychotrope est donc devenu cette réponse rapide et efficace que l’on apporte désormais aux problèmes sociaux, aux difficultés relationnelles, au désir de se sentir bien adapté, à la peur de tomber malade, à la « folie des gens normaux ».
Dans le monde actuel, vivre ressemble à une aventure de plus en plus périlleuse qui oblige souvent à se battre pour faire sa place et rester le meilleur. Il faut aussi se soumettre à cette espèce de dictature qui dit ce que l’on doit être, ce que l’on doit faire ou penser.
Ne pas correspondre à ces normes, c’est risquer d’être exclu ou inadapté. Le moindre écart, la moindre erreur, le plus petit signe de faiblesse sont immédiatement interprétés comme des symptômes pathologiques, des anormalités à supprimer, donc à médicaliser et même à psychiatriser.
L’horizon de la folie s’est ainsi considérablement élargi et celui de l’industrie pharmaceutique aussi. Tout peut être traité .
En médicalisant, on adapte, on normalise et on rassure si bien, que les psychologues eux-mêmes, aux USA, ont réclamé le droit de prescrire, comme si le produit chimique était maintenant l’unique réponse que l’on est capable d’apporter à la souffrance psychique.
Et parfois, avec l’importance qu’ont acquis les traitements chimiques, c’est un peu la même politique de la disparition du symptôme qui est pratiquée à l’hôpital.
Une patiente avait surnommé les infirmiers : « tueurs de fous ».
Effectivement, on s’imagine avoir remporté une victoire sur la folie quand on est parvenu à tuer ses symptômes, à faire disparaître ses manifestations.
Le soin se résume trop souvent à une prise de médicaments qui normalise les comportements et les pensées, au moins en apparence , qui élimine les idées fausses et les hallucinations.
Mais on oublie que la maladie est toujours présente et que le délire est aussi cette soupape de sécurité nécessaire qui aide le patient à vivre et à supporter sa souffrance. Il est quelques fois beaucoup plus malheureux quand il n’entend plus ses voix...
Il y a une évidente suprématie du traitement chimique par rapport aux autres possibilités de prise en charge de la folie à l’hôpital et de la non conformité dans la société.
La folie n’a plus droit d’asile et la différence n’est plus tolérée.
On a fixé des normes strictes auxquelles il faut correspondre.
Tout dépassement suscite une prescription qu’il est aisé de justifier en invoquant quelques causes organiques :
Aux USA, par exemple, on a cherché à dépister les individus à risque pour l’alcoolisme, la toxicomanie, le vol et la criminalité. En procédant scientifiquement, les études ont porté sur un dosage de la sérotonine. Et il apparaît que ce sont les noirs, surtout, qui seraient atteints d’une « forme de comportement agressif, anti-social et suicidaire ».
Elle correspondrait même, chez eux, à une affection héréditaire.
De cette façon, on peut expliquer les problèmes de société par des troubles physiologiques ou biologiques et les traiter avec des médicaments.
L’idéologie scientifique dominante, volontairement soutenue par les entreprises pharmaceutiques, a entraîné un usage inconsidéré du psychotrope et une énorme surestimation de ses pouvoirs thérapeutiques. On ne lui demande pas seulement de soulager la souffrance, mais de supprimer les troubles, de gommer les imperfections, de rendre adapté et conforme.
La psychiatrie risque de tomber dans ce piège et de devenir la science exacte du diagnostic, de l’isolation du symptôme et de la prescription.
Sans avoir encore compris ce qu’est réellement la folie, il est possible de la dissimuler sous une couverture chimique comme autrefois on la cachait derrière les murs de l’asile.
Une telle pratique peut amener la relation soignant soigné à se vider de son sens, à se priver de la parole pour se réduire à une prise de médicaments qui normalise le patient avant de le rendre à la société.
2
LE NOUVEAU PARTAGE DE LA FOLIE
La science, la médecine et surtout la neurochimie sont parvenues à médicaliser la psychiatrie et à lui communiquer un raisonnement matérialiste somatique. Une telle influence a entraîné des changements dans la façon de soigner et de comprendre les troubles mentaux. On assiste maintenant au retour en force des explications organiques.
Cet actuel processus de médicalisation est aussi soutenu par une politique de santé qui impose des contraintes réduisant considérablement toutes les perspectives d’ouverture de l’hôpital sur l’extérieur.
L’idée d’une psychiatrie de secteur, tournée vers la société, proche du malade et de son milieu de vie, qui s’intéresse à son histoire personnelle plus qu’à ses symptômes est peu à peu abandonnée.
L’obsession des chiffres, des statistiques et des budgets réclame désormais une « technique de soin » rapide et efficace ne faisant intervenir aucune réflexion psychosociologique.
Ainsi dévitalisée et privée de ses projets, l’institution se replie sur elle-même, préoccupée essentiellement d’assurer un fonctionnement intra-muros traditionnel qui, faute de moyens et de personnel, devient de plus en plus difficile.
La psychiatrie se retrouve dans une impasse. Son utilité est discutée et ses résultats sont jugés peu convainquant. On en conclut donc qu’elle coûte bien trop cher et que l’on peut, sans regret , amputer son budget pour abonder celui des centres hospitaliers généraux.
Pour cette raison, ces dernières années, les structures d’accueil en hôpital ont donc subi une réduction importante de leur capacité.
Croyant effectuer une mutation nécessaire, les services ont accepté les restructurations successives qui les obligent à fonctionner avec un personnel plus restreint.
Mais la diminution du nombre de lits ne s’est pas traduite, comme on aurait pu l’espérer, par l’ouverture de structures publiques extérieures, véritables alternatives à l’hospitalisation.
Effectivement, les seules qui ont pu, sans moyen financier supplémentaire et sans création de postes, être mises en place et résister, doivent se contenter de pratiquer une activité néo-asilaire, complètement tournée vers les services hospitaliers et non pas vers la communauté sociale. CMP (centre médico psychologique) Appartement thérapeutique, CATTP (centre d’activité thérapeutique à temps partiel), hôpitaux de jour, foyer, etc... n’échappent guère au champs habituel de la clientèle psychiatrisée qui fréquente l’institution.
Les admissions à l’hôpital se font en presque totalité par le service des urgences situé dans l’hôpital général, et il est très rare qu’elles soient le fait de ces structures intermédiaires qui, pourtant devaient avoir un rôle de dépistage, de prévention et de contact avec la population extérieure.
Dans le secteur intra hospitalier, au cours des vingt dernières années, le nombre de lits a diminué de moitié et la durée moyenne de séjour est passée de 250 jours à 59 jours.
On essaye de dissimuler l’obligation d’écourter ou de refuser les temps d’hospitalisations derrière une « volonté de ne pas trop psychiatriser », alors qu’elle est surtout imposée par un manque de lits.
A cette nécessité économique ne correspond, dans la réalité, aucun objectif thérapeutique.
Par faute de place, les malades sortent souvent trop tôt et dans de mauvaises conditions. L’atténuation des symptômes, étant, à tort, perçue comme un signe de guérison.
Sans bénéficier d’une aide véritable à la réinsertion et d’un suivi extérieur suffisant, ils s’exposent à des arrêts de traitements et à des rechutes inévitables.
Si l’on a réussi à faire baisser la durée moyenne d’hospitalisation, on reste bien impuissant devant l’augmentation des réhospitalisations. Et ces rechutes à répétition conduisent la psychose à évoluer d’une manière plus fragmentée mais qui aboutit plus rapidement qu’avant à une pérennisation des troubles.
Et on découvre ainsi l’effet pervers et paradoxal de cette nouvelle façon de soigner : en faisant sortir les patients trop vite, une autre chronicité apparaît, bien plus sournoise que celle institutionnelle, dans le décours même de la maladie.
La diminution des capacités d’accueil hospitalières n’a pas été réalisée en s’assurant de réelles possibilités de faire vivre les malades mentaux au dehors. Il n’y a pas eu de changements importants, bien au contraire, dans la communauté sociale qui pourraient laisser croire que sa tolérance à leur égard s’est améliorée et qu’ils y sont mieux acceptés aujourd’hui.
Même si le médicament a atténué ses comportements asociaux, la réintégration du patient demeure toujours aussi problématique. Il n’y a pas de place pour lui dans la société et sa sortie, qu’il a beaucoup de mal à assumer, lui est imposée par des exigences budgétaires, alors que son état de santé ne permet pas toujours de l’envisager.
La réduction du nombre de lits, qui devait assurer une économie substantielle, se traduit en réalité par une augmentation des prises en charge au long cours, évidemment plus onéreuses. On a fidélisé le client et oublié surtout que, lorsqu’un individu est désigné « psychiatrique » à un moment donné de sa vie, cette étiquette indélébile, lors du moindre évènement déstabilisateur, le reconduira toujours à l’hôpital .
Les lits « économisés », sensés permettre une mutation de la psychiatrie, un investissement extérieur dans de nouvelles orientations de travail sur le secteur, n’ont en fait pas profité au service publique.
Par contre, saisissant cette opportunité, de nombreux établissements privés ont pu s’ouvrir et innover cette autre façon de soigner qui autorise des objectifs thérapeutiques à servir des intérêts lucratifs. Ces cliniques attirent une clientèle constituée de pathologies légères ou non décompensées, qui avait manifestement de plus en plus de mal à se mêler à la population classique de l’hôpital psychiatrique et qui, en même temps, restait inadaptée aux normes sociales.
On assiste donc à un véritable partage de la folie, à une véritable ségrégation des malades qui rappelle celle du début du siècle :
- Il y a d’un côté les « petits mentaux », les « malades des nerfs » que l’on ne dit plus neurasthéniques, psychasthéniques ou névrosés mais déprimés, anxio dépressifs, insomniaques, surmenés, conjugopathes, etc... et pour lesquels on parle de « séjour en clinique ».
- Et d’un autre côté, il y a les « malades mentaux » ou les « vrais fous », c’est à dire les pathologies lourdes et incurables.
On y comprend les états d’agitation aigus, les psychoses chroniques et déficitaires, les psychopathies, les débilités et arriérations mentales que les MAS (maisons d’accueil spécialisées) refusent de prendre en charge et des maladies neurologiques présentant des risques de troubles du comportement.
C’est la population du service publique qui, peu à peu, redevient celle de l’asile avec son dénominateur commun d’incurabilité.
Elle représente la mauvaise folie, celle qui fait peur et que l’on attache (les « fous à lier »), celle qui nécessite des placements et qui cohabite mal avec la justice, celle aussi qui traduit le mieux les dysfonctionnements d’une société qui fabrique de l’exclusion.
C’est cette même folie que Pinel avait déchaînée que l’on rattache à nouveau pour la cacher, l’astreindre, l’endormir. Dans des temps plus courts maintenant, puisque l’on dispose de moyens efficaces pour effacer le symptôme et normaliser le patient, mais suivant des épisodes répétitifs où la chronicité et la désocialisation finissent par l’emporter.
A la peur de l’humiliation et de la punition que les malades retrouvent dans la contrainte des attaches et de l’enfermement, se rajoute celle de la prescription médicale qui, occupant de plus en plus de place, amène le soin à se confondre avec une prise de médicaments. Et, lorsque ceux cis ont amendé l’état de crise, le malade, à peine remis, est obligé d’aller affronter seul le même jugement social qui le condamne en le désignant fou et rend illusoire une quelconque réintégration.
L’asile a effectivement perdu son caractère thérapeutique. Si l’on considère le nombre d’entrées qui se font sous le mode des placements ( HO,HDT), on se rend compte que les soignants, insensiblement, se réhabituent à leur ancien rôle de gardiens représentant la Loi de 1838.
Le traitement s’éloigne de plus en plus de celui « moral et psychologique » préconisé autrefois par Pinel et Esquirol. Il est surtout une obligation de subir une privation de liberté et l’effet des médicaments pour répondre à une mesure de justice presque synonyme de punition.
Si l’on est arrivé à réduire la durée des internements, on en a encore que très peu changé les conditions.
Dans cette situation, la psychiatrie publique se retrouve en placement elle aussi, condamnée à vivre enfermée avec ses patients derrière ses murs et ignorante de tous les problèmes de santé mentale qui existent au dehors.
Qu’en est-il de la possibilité de sortir, d’aller à l’encontre des malades dans les familles, dans les milieux d’éclosion des psychoses, et partout où la souffrance psychique s’exprime pour accomplir les rôles essentiels de prévention et d’accompagnement en vue d’une meilleure intégration ? En privilégiant l’hospitalisation et la médicalisation, la psychiatrie a perdu sa fonction sociale, ce projet qui l’a fait naître et qui pourrait lui permettre de se distinguer noblement du secteur privé : montrer qu’elle est indispensable à la communauté non seulement pour contenir ses individus fous mais pour préserver les autres de le devenir.
Le contrôle des déficits, la réduction du personnel ont fait du soin un geste purement administratif et classiquement médical qui consiste à quantifier, à mesurer et à ranger la maladie mentale.
Tandis que le service public s’asphyxie, grâce à un désengagement de plus en plus évident de l’Etat et de ses administrateurs qui rongent ses moyens de survie, le privé, quant à lui, avec la bénédiction de la Sécurité Sociale, enregistre ses bénéfices, satisfait d’avoir trouvé un bon créneau pour rentabiliser une certaine forme de folie.
Ce sont des intérêts financiers surtout qui ont provoqué ce partage et cette ségrégation des malades et qui font que le système de santé se privatise. La prise en charge de la souffrance psychique n’est plus le souci principal de la collectivité.
La France compte le plus grand nombre de psychiatres, mais sur les 14500 , plus de la moitié exercent dans le privé ou en libéral. Ils ne font pas du tout le même métier que les hospitaliers . De nombreux postes de chefs de services sont vacants dans le public .Il faut bien reconnaître que, comme au début du siècle, celui qui s’engage dans la carrière d’aliéniste à l’hôpital ne s’assure pas d’une réussite professionnelle bien gratifiante.
Il y a environ 700 postes de praticiens hospitaliers en psychiatrie qui ne sont pas pourvus. Et après avoir supprimer les internes dans cette discipline, on a aussi supprimé le diplôme spécifique des infirmiers .
Avec un manque cruel de personnel, de lits et de structures adaptées, le soin ne peut plus être réalisé correctement. Ceci explique l’augmentation des prescriptions et le refus de l’hospitalisation qui conduit de plus en plus de malades à la prison ou en UMD (unités pour malades difficiles).
Ainsi, 20% de la population pénitentiaire présente des troubles psychologiques graves et en l’espace de trois ans, le temps d’attente pour obtenir une place en UMD est passé de un mois à un an .60 % des SDF présentent des troubles psychiatriques .
On peut citer, à ce sujet, l’exemple des USA, qui sont souvent considérés comme un modèle à suivre. Là-bas, les malades mentaux qui ont une assurance personnelle assez forte et une pathologie assez légère, peuvent aussi aller en clinique privée.
Par contre, les autres, ils se retrouvent dans la rue ou en prison, parce que très vite, faute de place, ils sont rejetés par l’hôpital.
En France, à force de détruire le système de soins publique, on arrivera rapidement à la même situation. Il y a plus de 200 000 personnes qui vivent dans la rue, ignorées de la sécurité sociale et des administrations, considérées comme disparues, décédées. Il y en a plusieurs millions, prises dans la spirale de l’exclusion, qui appartiennent à ce monde parallèle de la pauvreté que l’on ne veut plus voir, même si elle nous agresse et nous culpabilise.
Si la psychiatrie n’assume plus ses fonctions essentielles de prévention, d’assistance et de réintégration, la vraie folie, celle que l’on refuse de soigner, ira par la force des choses s’exprimer ailleurs, dans des débordements que l’on aura de plus en plus de mal à canaliser, même en prenant les mesures de répression les plus sévères.
Elle s’installera dans les rangs des marginaux, des exclus, des sans domicile...
Faudra-t-il alors, dans un avenir assez proche, recourir à un nouvel Édit de 1656, pour renfermer tous les parias, les déviants et les inadaptés de notre société, parmi lesquels on redécouvrira peut être encore le fou ?
3
LA FIN D’UNE PROFESSION
-Du savoir-faire à la « technique de soin » :
L’infirmier est celui qui, dans l’équipe soignante, passe le plus de temps au contact des malades. Et, de ce fait, malgré une position hiérarchique inférieure, il a sa propre connaissance des pathologies qui l’autorise aussi à pouvoir en parler.
Il assume au quotidien la coexistence de patients hospitalisés souvent contre leur volonté, dans un milieu où la promiscuité est à l’origine de nombreux problèmes. Il doit aussi constamment faire face à toutes les manifestations de la souffrance psychique, à des situations de crise et parfois de violence.
Confronté à l’insuffisance des traitements chimiques, il est obligé de trouver lui-même les réponses spécifiques adaptées à chaque cas, en se basant, la plupart du temps, sur un savoir-faire acquis par l’expérience.
Sa pratique le conduit à se montrer tolérant. Il accepte la maladie et essaye de la comprendre comme tous ceux qui, au fil des siècles, ont côtoyé des malades mentaux et cherché à expliquer les perturbations de leur pensée ou de leur comportement pour mieux savoir les soigner.
C’est à partir de l’expérience, de l’observation et de l’intuition surtout, que sont nées, peu à peu, certaines conceptions concernant les affections psychiques. Elles ont déterminé les fondements de notre psychiatrie, et chacun s’y réfère à sa manière et selon ses propres convictions personnelles.
Néanmoins, au cours de l’histoire, une préoccupation est apparue comme essentielle en pathologie psychiatrique : pouvoir prendre en charge les patients, à tous les moments de leur vie et même en dehors d’une hospitalisation, grâce à la mise en place de mesures de soutien psychologique et social.
Pour cette raison, l’infirmier a été nommé : « de secteur psychiatrique ». Et depuis, son rôle est sensé s’étendre au delà des murs de l’hôpital ,ce qui implique que les soins qu’il dispense ne doivent pas être réservés à l’unique présentateur de symptômes.
Effectivement, se cantonner à la seule maladie mentale ne semble pas être une solution satisfaisante. Pour bien traiter la souffrance psychique, il est nécessaire de l’envisager comme l’expression humaine d’un malaise qui, dépassant le sujet lui-même, se ramifie dans un contexte familial et social.
Ainsi définie par le projet de sectorisation, la fonction de l’infirmier se situe à la croisée du sanitaire, du social et du légal, ce qui donne toute sa spécificité à cette profession.
Alors qu’en médecine, on s’évertue à combattre et à vaincre la maladie, d’une façon anonyme, en lui supprimant ses manifestations, en psychiatrie, il en va tout autrement. La folie ne se guérit pas et le soin ne peut s’envisager que comme une aide psychologique amenant le patient à maîtriser ses difficultés, à vivre avec, et son entourage à mieux le comprendre et le supporter.
La démarche est complètement différente.
Ce n’est pas tant de compétences médicales dont il faut faire preuve, que de modestie quant à l’efficacité des traitements et surtout d’une capacité relationnelle importante.
L’infirmier ne peut pas se protéger derrière une neutralité technique, si bienveillante soit-elle, au risque de s’éloigner complètement de la souffrance et de ne plus en saisir le sens. Il ne peut pas rester insensible à ce sentiment d’incertitude et de malaise impalpable que la psychose induit et qui n’est pas supportable pour un soignant formé exclusivement à la rigueur médicale.
Il faut accepter que la folie nous atteigne dans nos propres faiblesses, comme elle atteint parfois toute une famille.
Soigner, c’est se montrer plus fort, capable de contenir les émotions qu’elle provoque immanquablement en nous, afin de prouver au patient qu’elles ne sont pas toujours envahissantes et destructrices.
S’il ébranle notre personnalité, c’est pour reconstruire la sienne et s’il se sert de notre esprit, c’est pour pallier aux défaillances du sien.
L’expression « prendre soin de », si communément utilisée aujourd’hui pour uniformiser tous les soignants, prend donc un tout autre sens en psychiatrie.
La maladie mentale restera toujours une des possibilités de l’âme humaine, que l’on ne peut pas atteindre avec les seuls médicaments.
Mais ces dernières années, cette fonction de soignant et cette façon d’appréhender la folie font l’objet de nombreuses critiques. Toute l’organisation de la psychiatrie, ses choix et ses projets semblent ne plus pouvoir résister aux nouvelles normes fixées par la nécessité économique de maîtriser les coûts hospitaliers et par les raisonnements matérialistes imposés par la médicalisation.
En conséquence, l’infirmier assiste à une remise en cause de son engagement et de ses possibilités d’action. On lui demande de fonctionner avec des valeurs rationnelles dans une psychiatrie qui apporte surtout des réponses « diagnostic traitement » fournies par la science et qui n’a que très peu de moyens pour exister réellement à l’extérieur.
Le soin se pratique surtout à l’hôpital et correspond de plus en plus à un acte médical pur pouvant se comptabiliser en point et en temps.
Condamné à ne plus s’intéresser au psychologique et au social, l’infirmier voit son rôle se limiter au sanitaire, au risque de lui interdire d’être vraiment thérapeute.
Pour chaque patient, un calcul est établit qui doit permettre d’évaluer avec précision, grâce à un recueil de données médicales, à des grilles de lecture pertinentes et à des outils informatiques le niveau de soin requis.
De la même manière, d’après la charge de travail, on peut déterminer exactement le profil de poste et s’assurer sans conteste de l’efficacité de la fonction de l’infirmier.
C’est à l’aide de cadres, de structures, de limites, de chiffres, de codes, de statistiques que l’on s’apprête, encore une fois, à mettre de l’ordre dans la folie. Ce sont de nouvelles grilles, de nouvelles chaînes qui nous protègent et éloignent la maladie, mais qui peuvent se montrer plus efficaces pour la contenir que pour la comprendre.
On cherche à définir un système de prise en charge qui ne permette plus aucune erreur ni aucune défaillance de la part du patient ou du soignant. Il faut que tout soit maîtrisé. Le moindre écart ne peut plus traduire la désorganisation psychique inhérente à la maladie, mais seulement une carence dans le système de soin justifiant une correction par des médicaments ou le recours à la contrainte physique et, dans tous les cas, une redéfinition plus affinée des rôles et des fonctions.
Dans cette psychiatrie qui prend des airs de science exacte, le soignant ne doit plus être atteint dans son intégrité et son confort. Une « distance thérapeutique » le sépare du patient, ce qui élimine toute forme de sensibilité et délimite précisément le normal de l’anormal.
Ainsi le risque de trahir des faiblesses, d’être spontané ou simplement d’accorder sa confiance disparaît derrière le souci principal d’appliquer les actes prescrits et consignés, en bon fonctionnaire.
Pour le malade, l’hôpital ressemble de moins en moins à ce lieu où il peut vivre sa folie et essayer de la comprendre au travers du soutien que lui apporte le soignant. Le recours à la psychologie embarrasse, n’est pas assez structurant. On lui préfère des méthodes qui amènent le patient à se ranger rapidement en faisant disparaître ses comportements anormaux.
La souffrance n’a plus le droit de s’exprimer par des apparences jugées intolérables : entendre des voix, rester dans son lit, ne plus se laver, se promener nu, etc...
Le bien-être du malade passe forcément, on en est convaincu, par l’absence de tous ces symptômes, de toutes ces excentricités !
Dans son travail quotidien, l’infirmier déjà peu gratifié, se sent de plus en plus disqualifié ou même inadapté. On ne tient pas compte de son expérience. Il lui arrive trop souvent de faire semblant, d’obéir aux nouvelles exigences sans y croire, d’adhérer à des projets ou à des décisions qui ne sont pas les siens. Par obligation, il fait comme le malade, il se soumet et se conforme, dans sa façon d’exécuter, mais sa façon de penser s’y refuse, et entre les deux, l’écart se creuse toujours plus. Il oppose quelques fois une certaine force d’inertie, qui est alors interprétée comme un « désinvestissement » ou une « usure professionnelle »...
En réalité, le mal est plus important. Outre la fonction du soignant, c’est en fait la place du malade dans notre psychiatrie, l’existence même de la folie, qui semblent remises en cause.
En établissant des rôles, des fonctions, des cadres, des structures, on cherche à définir un soin infaillible auquel la maladie mentale ne devrait pas résister. Il est réglementé selon un ordre hiérarchique et s’appuie sur le modèle médical que l’on reproduit fidèlement en psychiatrie. Il se calcule, se programme, se préétablit. Objectif et rationnel, il ne laisse aucune place au hasard ou à l’incertitude.
Il ne doit pas y avoir de différence entre une unité de médecine et une unité de psychiatrie. Partout, le même règlement impose l’ordre, le rangement, la propreté. Les services sont astiqués du matin au soir, les patients aussi. La relation thérapeutique, de la même façon est nettoyée, aseptisée ; elle devient médicale et technique.
Mais il semble bien que, malgré cette méthode de soin infaillible, les malades ne s’en portent pas mieux, même s’ils sont bien propres sur eux …
Ce système qui rend uniforme et identique ne laisse plus de place à la folie. Elle n’a plus son droit d’asile, sa possibilité d’être vivante, agie et parlée en un lieu qui la protège et qui la soigne.
Accorder un temps à la parole était autrefois considéré comme un moment essentiel en psychiatrie et comme thérapeutique principale. Aujourd’hui, ce temps-là est devenu inutile et superflu car il ne correspond pas à la certitude d’effectuer un soin, un acte tangible et quantifiable, c’est à dire médical.
On ne cherche plus à aider le malade à vivre avec sa folie, à retrouver en lui les ressources nécessaires pour se reconstruire. Il faut le débarrasser de ses symptômes, normaliser ses comportements pour qu’il puisse retourner le plus vite possible dehors.
Dans de telles conditions, le patient est amené à se renfermer avec sa souffrance, à apprendre à étouffer son délire. Il va ressembler à ce qu’il est à l’extérieur, un exclus, victime d’une condamnation morale, d’un étiquettage diagnostic et d’une soumission passive.
-Un soin bien administré :
Le manque de confiance aux possibilités de prise en charge psychologique et sociale rend la maladie mentale de plus en plus incompréhensible et inaccessible. Ceci se traduit par le retour des explications organiques et par l’application plus systématique des traitements chimiques et des contraintes physiques. L’enfermement, peu à peu, reprend ses droits et l’infirmier a l’impression de retrouver son ancien rôle de gardien.
La folie s’apparente à nouveau à une faute qu’il faut corriger et le soin représente cet acte médico-légal passant par un dispositif pénal, des mesures de contention et de placements.
Cette situation peut s’expliquer par un découragement et une démission des soignants, mais consécutifs à une perte progressive de toutes leurs possibilités d’action.
Pour des raisons économiques, la prise en charge de la folie est désormais dans les mains d’un pouvoir administratif qui, considérant soignants et soignés comme des numéros, instruments d’une même entreprise, cherche avant tout à s’assurer d’une nécessaire rentabilité.
Ceux qui décident des objectifs de soins et des projets d’établissement ne sont plus ceux qui soignent.
Les médecins psychiatres ont perdu leur appellation pour devenir de simples praticiens hospitaliers, et, volontairement ou pas, ils se sont mis à l’écart, se réfugiant derrière ce dernier rempart de leur pouvoir que représente la prescription.
Dans ces conditions, l’infirmier se retrouve davantage soumis à une autorité administrative que médicale. Jour et nuit, il est encadré étroitement par de nombreux surveillants qui réglementent le soin dans un esprit d’absolue conformité à des impératifs budgétaires et législatifs.
Ils incarnent, parfois sans s’en rendre compte, ou malgré eux , ce pouvoir administratif qui s’infiltre jusque dans la pratique quotidienne avec ses objectifs de quantification et d’informatisation et ses conceptions médicales. Le « dossier de soin » actuellement utilisé, illustre bien cette tentative d’aliénation du soignant par le gestionnaire.
Il s’agit du même dossier que celui qui est utilisé en médecine, c’est dire la particularité que l’on accorde à la psychiatrie. Ayant apporté entière satisfaction en soins généraux, on ne comprend pas pourquoi il n’en ferait pas autant avec les maladies mentales.
Ce dossier représente à la fois le processus actuel de médicalisation de la folie dans lequel la relation au patient devient technique et aseptique et aussi le leurre d’un pouvoir que l’on a fait semblant d’accorder aux infirmiers. Dans la réalité, il a encore réduit davantage leur capacité à s’investir dans une relation thérapeutique, leur spontanéité, leur sensibilité et leur autonomie, tout en alourdissant considérablement par contre, leur responsabilité juridique. Il est utilisé surtout pour se garantir dans l’exécution des consignes et des prescriptions, bien plus que pour soigner.
C’est l’instrument administratif avec lequel on apprend à traiter les troubles mentaux d’une façon organique et rationnelle, en ayant la certitude d’arriver enfin à mettre de l’ordre dans la folie.
La « démarche de soin » obéit à ce raisonnement médical qui cherche à isoler le symptôme pour le supprimer. Le délire, comme la fièvre, est à abattre. La souffrance, elle-même, ne s’écoute pas, elle devient aussi une anormalité à supprimer.
La folie se retrouve assimilée à une maladie organique, à une « ratée de la mécanique » que l’on doit traiter avec les méthodes pragmatiques de la médecine. Ainsi, sans connaissance et sans expérience particulières dans ce domaine, on peut soigner un fou comme un autre patient.
Le tronc commun d’étude en formation infirmière et le peu d’heures de stage et de cours consacrées à la psychiatrie en sont bien significatifs.
Ce dossier s’affiche donc comme l’outil « diagnostic et traitement », indispensable aussi en psychiatrie. Comme les médecins avec le DSM, les infirmiers disposent désormais d’un instrument qui délimite précisément leur fonction : ils puisent eux aussi dans une liste de symptômes tout prêts rédigés celui qui identifie le malade. Une fois ce « diagnostic infirmier » posé, ils se reportent à la page indiquée dans leur manuel interactif, pour y trouver la conduite thérapeutique adaptée.
Il n’y a donc plus besoin de se fier à son expérience, à son intuition ou à sa sensibilité... Tout est inscrit, codifié. L’erreur est impossible. Cette logique de soin rend semblable, identique, n’admet aucune différence et crée des soignants types et des patients types, objets de traitements standardisés.
Aujourd’hui, la pratique du soin n’est plus étayée et renforcée par une réflexion théorique. Cette absence de tout discours social sur la folie permet à l’héritage médical de redevenir prédominant en psychiatrie. On constate d’ailleurs que la formation des différents soignants les conditionne réellement à travailler dans ce sens là.
Non seulement il n’existe plus d’enseignement particulier pour préparer au métier d’infirmier en psychiatrie, mais on ne reconnaît même pas la validité du diplôme et la compétence de ceux qui sont en fonction.
On cherche à supprimer une profession et surtout à mettre fin à la prise en charge spécifique de la maladie mentale.
Des infirmières « diplômées d’Etat », techniciennes du soin somatique, peuvent exercer désormais sans problème dans une psychiatrie enfin débarrassée de toutes ses élucubrations sur la psychologie.
Les psychiatres eux-mêmes, restent avant tout formés à la médecine générale, aux disciplines neurologiques, biologiques ou pharmacologiques. L’étude du comportement et du développement de la personnalité, l’apprentissage des méthodes de traitement psychologique sont facultatifs et laissés à l’appréciation de chaque médecin. On ne voit plus d’internes en psychiatrie.
Il n’est d’ailleurs plus obligatoire de justifier d’une formation spéciale pour soigner la folie, puisqu’un généraliste peut aisément accéder à un statut de praticien hospitalier.
L’histoire de la maladie, ses causes et ses explications, sa dimension sociale, le sens du symptôme et de la souffrance... Ces interrogations, qui ont fait toute l’originalité de la psychiatrie, semblent être ignorées. Et les réponses apportées, jugées trop évasives, déroutent ou indisposent.
Il importe davantage maintenant d’obtenir des résultats quantifiables, de rentabiliser les soins, d’agir dans l’efficacité et la certitude.
Pour cette raison, on accepte de moins en moins que l’hôpital reste encombré de malades qui, finalement, ont peu de chances de guérir ou de s’améliorer. Le système de soin actuel oblige donc à établir une sélection et met de côté ceux qui sont rebelles à la méthode « diagnostic – traitement », pour les faire sortir du domaine de la psychiatrie en disant que l’on ne peut plus rien faire pour eux.
C’est le cas des pervers, des toxicomanes, des alcooliques, des psychopathes et des psychotiques chroniques, qui forment une population irrémédiablement vouée à l’exclusion et à la marginalisation.
Concernant les psychotiques, on sait que l’évolution de la maladie est souvent très chaotique. Elle se fait, dans 75% des cas, soit vers l’aggravation, soit, et c’est moindre mal, vers la chronicisation des troubles. Ce phénomène a toujours posé problème en psychiatrie.
Après de longues années de traitement, les malades, en général, connaissent enfin une période de stabilisation, qui reste malgré tout assez précaire. Ils présentent moins d’agitation, de délires ou d’hallucinations mais ont encore besoin de surveillance et de prise en charge. Même si elle demeure plus discrète, la maladie reste profondément inscrite en eux, laissant toujours craindre des rechutes. Ce sont des patients qui, très souvent, n’ont pas d’autre famille que l’hôpital, où ils ont, du fait de leur pathologie, passé leur vie.
Mais les règles d’économies et de restrictions et les objectifs de soins actuels ne tolèrent plus ces chroniques. Ils sont donc contraints de quitter l’hôpital pour aller occuper les lits vides dans des maisons de retraite, parfois bien avant soixante ans, ou dans des structures non médicalisées qui découvrent alors cette opportunité d’une récupération lucrative des malades mentaux.
Ces Établissements fonctionnent avec un personnel restreint et non formé. Les “pensionnaires”, n’étant plus considérés comme malades, ne bénéficient plus d’une prise en charge médicale et ne dépendent plus de la sécurité sociale.
On peut se demander qui paye la facture et surtout si de telles alternatives à l’hospitalisation conservent réellement quelque chose de thérapeutique !
Des infirmiers mécontents, dont on remet en cause la valeur de leur diplôme et de leur expérience, des médecins qui se taisent, des malades que l’on passe dehors et qui ne méritent plus de recevoir des soins, une administration qui impose ses lois budgétaires et son absence d’humanité... Tous ces éléments démontrent que la psychiatrie connaît une situation difficile.
On nous parle d’une mutation nécessaire !
Est-ce que c’est une société plus humaine, qui accepte mieux ses malades, ses anormaux et ses déviants, que l’on a envie de construire ?
En tout cas, il semble bien que l’on s’achemine vers la fin d’une profession et vers l’abandon des idées, des conceptions et des projets qui avaient donné naissance à la psychiatrie.
Une certitude demeure : il y aura toujours des malades mentaux !
Ce dont on peut être moins sûr, c’est de trouver encore des soignants pour les prendre en charge.
Voici ce que les Etats Généraux de la Psychiatrie, qui ont eu lieu à Montpellier en juin 2003, ont réclamé avec insistance :
(Re)développer la recherche clinique en psychiatrie .
Redonner aux soins la dimensions du collectif dans les institutions .
Réaffirmer la singularité des stratégies de soins au dépend des protocoles standardisés .
Rester vigilants face à la fascination du scientisme .
Un budget spécifique pour la psychiatrie, augmenter le nombre de lits et les structures extérieures, maintenir le nombre de psychiatres, augmenter celui des internes et des infirmiers .
Une formation spécifique des soignants .
Réaffirmer l’importance du secteur psychiatrique et renforcer tous les moyens de prévention .
Refuser la primauté du pouvoir administratif au détriment de la responsabilité soignante .
Supprimer le forfait hospitalier pour les malades bénéficiaires de l’AAH
Etablir des collaborations indispensables entre les instances juridiques et les instances soignantes .
Aucune mesure n’a été mise en place depuis qui pourrait correspondre à ces attentes .
Au contraire, on constate que des pans entiers de la misère sociale demandent aujourd’hui une prise en charge qui se télescope avec le manque de lits, le manque de soignants . Et dans le même temps, des faits divers dramatiques sont montés en épingle et mis en avant par les médias . On criminalise les malades mentaux et on inspire la peur de la folie . Redeviendrait-elle cette bestialité d’autrefois ? Avec le projet sur la prévention de la délinquance, et avec celui concernant les pervers sexuels récidivistes, avec la création d’un fichier pour mineurs délinquants, on tente de mêler encore psychiatrie et loi sécuritaire, on tente de faire cet amalgame insupportable entre délinquance et maladie mentale
La confusion actuelle entre espace thérapeutique et espace judiciaire est totale . On demande même à la psychiatrie de prédire l’avenir en disant si le « malade » va récidiver . La peine et la prison sont redevenues thérapeutiques .
Jusqu’à présent l’aliénation était une contre indication au procès . Les délinquants allaient en prison, tandis que les fous allaient à l’asile . Depuis quelques années, les non lieux psychiatriques deviennent de plus en plus rares, 424 en 1990, 233 en 2003 et cette tendance concerne toute l’Europe . Considérés d’abord comme dangereux et non pas comme souffrants, les malades arrivent en prison, comme s’ils étaient coupables d’être malades .
Suite à divers accidents on a doté les hôpitaux psychiatriques de boîtiers d’alarme individuel, de vigiles, de nombreuses chambres sécurisées . On a même pensé à créer des « unités pour malades agités et perturbateurs » . Ou des « centres fermés de protection sociale » sensés accueillir une fois leur peine purgée, ceux que l’on « estime » encore dangereux, sorte de Guantanamo mi prison mi hôpital .
La politique sécuritaire enferme la psychiatrie avec la violence . Alors que cette violence n’est pas due à la maladie, les patients l’amènent avec eux, mais elle vient du dehors, de la situation d’abandon, de la misère sociale, du sentiment de révolte .
C’est David Cooper, psychiatre, qui disait en 1960 : « la psychiatrie avale tout ce que la société vomit » .
On hospitalise beaucoup aujourd’hui, pas tant pour la gravité des troubles ou la souffrance des malades, mais surtout pour la gêne qu’ils représentent chez eux, dans les foyers, les maisons de retraites ou dans la rue .Les malades, les pauvres, les chômeurs, les marginaux, les délaissés qui représentent toute la détresse de la société, la psychiatrie doit exercer sur eux une autorité, une violence légitime .Il faut à nouveau les cacher et les faire taire La psychiatrie doit adoucir les marques faites par la brutalité d’une société où la compétition laisse nombre de gens sur le pavé . Alors on condamne ceux qu’on pense être dangereux et on les prive de liberté . On peut ainsi décider qu’un certain nombre de gens sont irrécupérables et charger la psychiatrie de faire de la répression et pourquoi pas de l’eugénisme . On entend dire aujourd’hui qu’un pédophile « naît » pédophile, que la délinquance est génétiquement programmée et que ceux qui se suicident de toute façon avaient une fragilité au départ…
On est tout près des théories organicistes qui pensent que l’être humain est entièrement déterminé par la génétique . Et c’est bien le discours de la loi sécuritaire repris par les partisans d’une psychiatrie de laboratoire .
C’est complètement faux, on le sait . On est tous différents,on a pas tous les mêmes cheveux ni la même peau, il y a des grands, des petits, des forts et des moins forts . Mais chacun a le droit de vivre !
Le malade même si c’est un être faible, ne doit pas être assujetti, ce n’est pas un numéro, encore moins un coupable ou un prisonnier . Il ne perd pas ses facultés de penser, de choisir et de décider d’aller mieux, même si ses facultés mentales semblent inhibées par la maladie, elles le sont en réalité bien davantage par les soignants .
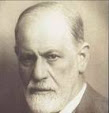
1 commentaire:
Je recommanderai à tous ceux qui recherchent un prêt commercial à M. Benjamin qui m'a aidé avec un prêt de quatre millions USD pour démarrer mon entreprise et c'était rapide.Lors de l'obtention d'un prêt de leur part, il était surprenant de voir à quel point ils étaient faciles à travailler. sécurise. Ce fut définitivement une expérience positive, évitez les arnaqueurs ici et contactez M. Benjamin On. 247officedept@gmail.com. WhatsApp ... + 19893943740. si vous recherchez un prêt commercial.
Enregistrer un commentaire