
XX e SIECLE : 1ère PARTIE
1
LA NEUROLOGIE S’IMPOSE
-Vers une psychiatrie biologique :
Si en Allemagne, au début du siècle, on privilégie l’approche théorique et la réflexion philosophique, pour parler de la maladie mentale, en France, la psychiatrie reste très attachée à la clinique et le discours qui prévaut est celui organique.
En effet, la science qui occupe toute la place est la neuropsychiatrie.
Les découvertes récentes en microbiologie, en biochimie, en génétique ou celles qui concernent la structure du système nerveux, s’étendent aux pathologies mentales et tendent à prouver, une fois encore, la cause organique de la folie.
On soigne la paralysie générale par impaludation et cette méthode de traitement devient un modèle à suivre : à l’origine de toute perturbation psychique, on doit forcément pouvoir identifier un dysfonctionnement physique.
L’épidémie d’encéphalite léthargique de 1917 qui touche toute l’Europe, fait avec la grippe espagnole, plus de morts en France que la Grande Guerre. Et les survivants souffrent de séquelles neurologiques si importantes qu’on les croit atteints de démence précoce. Contraints de rejoindre les aliénés, ces malades finiront leur vie à l’asile. Et on en déduit donc que des agents infectieux peuvent aussi être la cause des maladies mentales.
Par ailleurs, des recherches en chimie biologique démontrent comment une perturbation du métabolisme de certains enzymes (phénylalaline, galactotransférase, tryptophane) peut se manifester par des arriérations mentales. On relève aussi qu’une carence en vitamine B est parfois responsable de troubles neuropsychiques et que les hormones produites par des glandes (surrénales, thyroïde, hypophyse, hypothalamus, thalamus), semblent être concernées dans l’apparition de certaines perturbations psychiques.
D’autres études, portant sur l’hérédité, démontrent que des aberrations chromosomiques entraînent des troubles mentaux tels que le mongolisme ou la débilité.
Quelques statistiques établissent déjà la responsabilité de facteurs héréditaires dans l’éclosion de la schizophrénie.
La cause organique est toujours la seule explication crédible à l’émergence de la folie. En corollaire à cette organogenèse, va se poursuivre avec assiduité, l’exploration du cerveau et du système nerveux.
On confirme la circulation de l’influx nerveux mise en évidence au siècle passé. Les nerfs sont bien le siège de décharges électriques. L’électroencéphalogramme, inventé en 1925, permet d’enregistrer cette activité cérébrale et de diagnostiquer certaines anomalies. Mais on en vient rapidement à s’intéresser à ce qui se passe à l’intérieur du cerveau. On essaye d’y enfoncer des électrodes pour découvrir des régions jusqu’alors inexplorées. Cette méthode appelée « Stéréotaxie » se développe durant la deuxième guerre mondiale et apporte des informations sur le fonctionnement et la structure du cerveau.
En outre, d’autres recherches démontrent que les nerfs n’ont pas seulement qu’une activité électrique, ils libèrent aussi des substances chimiques qui elles, semblent être les vrais porte paroles de l’influx nerveux. On identifie l’acéthylcholine et la noradrénaline que l’on nomme « neuromédiateurs ».
Mais ce mécanisme chimique sera réellement prouvé en 1951, lorsque l’on pourra travailler à l’échelle d’une seule synapse.
L’idée d’une psychiatrie biologique s’impose de plus en plus. Les aliénistes, en majorité, se prétendent tous neuropsychiatres, indiquant ainsi clairement l’importance que l’on accorde désormais à cette nouvelle science matérialiste en plein essor : la neurophysiologie.
Descartes avait raison quand il parlait de l’ « homme machine ».
Le cerveau, les nerfs, l’influx nerveux, les molécules chimiques, nouveau langage de la psychiatrie, prouvent bien l’existence d’une mécanique humaine.
Dès lors, les rationalistes vont se mettre à répertorier de nombreuses anomalies neurophysiologiques susceptibles d’apporter une explication à la folie.
Et ce sont surtout les recherches sur l’alchimie de l’esprit et de la pensée qui, au cours de ce siècle, connaîtront un énorme succès.
-Le partage de la folie :
Avant la deuxième guerre mondiale, l’assistance aux malades mentaux en France, reste largement centrée sur l’institution asilaire.
Mais le courant organiciste dominant parvient à créer des services de neurologie, au sein même des hôpitaux .
On assiste alors à une ségrégation des malades mentaux, à un véritable partage de la folie.
Il y a d’un côté le « domaine psychique pur », les « malades des nerfs », soignés dans les services de névrologie ou de neurologie, et, d’un autre, le « domaine mental », la psychiatrie lourde avec ses asiles et ses aliénés incurables.
- Le domaine psychique :
Ce sont les « petits mentaux » ou « malades nerveux » présentant des troubles psychiques purs : psychasthénie, neurasthénie, hystérie, hypocondrie. Ils sont soignés dans les services de neurologie des hôpitaux de médecine, dans des établissements ou des cabinets privés. Les traitements utilisés sont des calmants, des toniques, des laxatifs, des diurétiques, des bains auxquels on associe parfois un peu de psychothérapie.
- Le domaine mental :
Ce sont les aliénés chroniques incurables qui souffrent de troubles mentaux importants : démence, paralysie générale, alcoolisme, encéphalite, débilité, dégénérescence, délires chroniques (psychoses), séquelles neurologiques de guerre. Les traitements sont les mêmes que ceux pratiqués au siècle passé : saignées , suspensions à des cordes, chaises rotatives...ou bastonnades.
A Paris, la neurologie est à la Salpêtrière, avec Charcot, tandis que les « maladies mentales et de l’encéphale » sont à Ste Anne.
Si la neurologie, en tant que science nouvelle, bénéficie d’un essor prodigieux et d’une grande célébrité, la psychiatrie elle, avec ses asiles, doit se faire oublier.
Peu de médecins s’engagent dans la carrière asilaire, parce que les aliénés, ne présentant pas de lésions précisément localisables au niveau cérébral, n’ont pas droit aux soins dispensés par la médecine enseignée à la faculté.
L’asile et l’hôpital sont deux mondes à part, indépendants aussi bien au niveau de l’organisation qu’à celui du recrutement et de la formation du personnel.
Mais un problème inquiète de plus en plus les administrateurs : la population de l’asile est en constante augmentation. Il y a encombrement, on entasse les pensionnaires.
Si le nombre de paralytiques généraux commence à décroître, celui des alcooliques monte en flèche.
En outre l’asile est obligé d’accueillir beaucoup de patients qu’il avait refusés auparavant, tels que les arriérés, les épileptiques, les déments, etc, dont personne ne veut . Il devient un fourre-tout qui correspond au renfermement, à la chronicité, à l’incurabilité et à la dangerosité.
Les traitements restent barbares et médiocres et les médecins sont absents ( 1 pour 500 malades environ).
L’asile a ainsi renoncé, en quelques décennies, à sa prétention thérapeutique. Il est une mise à l’écart associée d’un pronostic pessimiste. Il est redevenu ce qu’il était autrefois : un « quartier d’insensés » ou un « dépôt de mendicité ».
Les malades s’y désocialisent et s’y chronicisent. Les soignants n’y ont qu’un rôle de gardiens représentant la loi de 1838.
Et même un peu plus tard, lorsque l’on décidera, en 1937, sous le gouvernement du front populaire, de donner aux asiles le nom respectable d’ « hôpitaux psychiatriques », ce changement d’appellation ne modifiera guère leur fonctionnement.
En ce début de XX e siècle, la folie est donc partagée. On distingue les malades curables, qui intéressent la neurologie, et les incurables, objets d’une psychiatrie asilaire, abandonnée derrière ses murs, et pour laquelle on commence à parler de « coûts économiques » et d’ « inefficacité thérapeutique ».
Edouard Toulouse, politicien de gauche, soutenu par deux médecins, Charles Richet et Alexis Carrel qui recevront le prix Nobel de médecine, vont proposer, au nom d’un eugénisme, des solutions pratiques dans la lutte contre les maladies mentales.
Ils considèrent qu’il y a une hiérarchie des races humaines et une possibilité de dégénérescence raciale due à des maladies héréditaires. En conséquence, ils envisagent de donner aux médecins le pouvoir de discriminer les maux incurables, dont il est nécessaire d’éviter la propagation, de ceux curables auxquels on doit réserver les soins.
Et ce projet s’accorde très bien avec le partage déjà effectué des « petits mentaux » et des « aliénés ».
On préconise alors la stérilisation, puis l’euthanasie pure et simple des malades internés dans les asiles.
En Allemagne, à la fin des années 20, une législation est votée qui prévoit, entre autres, l’élimination des schizophrènes.
Ensuite, c’est le projet nazi dit « action T4 » qui annonce: « La destruction des vies qui ne valent pas la peine d’être vécues » .
Ce programme est loin de faire hurler les psychiatres allemands qui, à 69%, rejoignent les rangs du parti nazi, acceptant ainsi complètement l’idée d’une purification de la race.
En France, cette théorie raciale reçoit un écho favorable chez des psychiatres comme De Clérambault qui, plus tard, sera reconnu par Lacan comme le seul maître en psychiatrie à cette époque.
En outre, le « Traité des dégénérescences » de Morel et Magnan reste encore bien présent dans les esprits.
En 1936, la « Commission de Surveillance des asiles publics d’aliénés du département de la Seine » déclare alors consciencieusement :
« Considérant que le nombre d’aliénés augmente dans des proportions alarmantes, qu’il n’est pas douteux que l’hérédité en soit une des causes principales...Il est du devoir des pouvoirs publics de prendre d’urgence des mesures tendant à préserver l’avenir de la race française. La commission a l’honneur de demander à Mr le Ministre de la Santé Publique de rechercher les moyens de faire pénétrer dans les familles françaises, en vue d’encourager la pratique de l’eugénisme volontaire, la notion de l’hérédité propagatrice des maladies mentales »
Les psychiatres français ne s’insurgent pas contre ces mesures, même si aucun programme de stérilisation n’est officiellement mis en place dans les asiles.
En réalité, la solution s’impose d’elle-même durant les années de guerre :
Une volonté masquée d’euthanasie se fait sentir lorsque l’on rationne les malades internés ou que l’on réquisitionne les produits des fermes asilaires, en laissant les pensionnaires mourir de faim.
Sur 115 000 malades mentaux recensés en 1940, 40 000 agonisent dans des conditions effroyables de famine et de froid.
A Lyon, à l’hôpital du Vinatier, 2773 patients décèdent des conséquences de la dénutrition.
Suite au conflit mondial, dans tous les pays occidentaux, la population asilaire se vide un temps, mais pour mieux se remplir ensuite avec les séquelles neurologiques de guerre.
L’asile ressemble toujours à un lieu maudit de désolation, de chronicité et d’incurabilité.
Pourtant, il y a un hôpital en France qui semble échapper à cette règle. C’est celui de St Alban, en Lozère. On y parle de réforme, de psychothérapie institutionnelle, d’ouverture des portes... d’une psychiatrie différente.
Cette expérience, qui se diffusera dans toute l’Europe, oblige à se poser la question :
Comment un asile psychiatrique, définit par Pinel et Esquirol comme thérapeutique, arrive-t-il à transformer des cas peut être guérissables en cas chroniques ou à devenir un instrument de mort ?
2
UN AUTRE DISCOURS SUR LA FOLIE
-Freud et la psychanalyse :
Les progrès scientifiques réalisés en neurologie depuis le début du siècle (découverte du neurone et des dendrites), ont nettement fait décroître l’intérêt pour la psychologie.
Même si l’on ne peut plus nier maintenant que la vie psychique déborde largement de la conscience, on ne sait pas comment prouver la responsabilité de ces « forces obscures », de cette « vérité cachée », de ces « conflits intra psychiques profonds » dans les maladies mentales.
Les quelques psychiatres qui essayent encore d’apporter une explication psychologique à la folie, ne sont guère écoutés, car ils n’utilisent pas un discours scientifique dans une époque entièrement dominée par la neurologie et l’histopathologie.
Si Freud parvient à s’imposer, c’est parce qu’il se sert de sa formation de biologiste et de neurologue pour élaborer sa théorie sur l’inconscient. Et la méthode de traitement des troubles psychiques qu’il propose est à la fois psychologique et scientifique.
En 1886, il rejoint Charcot à Paris, pour participer à ses études sur l’hystérie. Et, comme Bernheim, il se rend compte que l’hypnose, malgré son côté magique et fascinant, n’a en fait que des effets thérapeutiques limités. Effectivement, la libération des émotions refoulées, dans l’état hypnotique, ne produit pas la guérison mais un simple soulagement des tensions accumulées.
Et, très souvent, les symptômes initiaux disparaissent pour être ensuite remplacés par d’autres.
Il faut donc rechercher une méthode qui permette non pas d’éviter mais de surmonter les résistances de la personnalité à se remémorer et à revivre les expériences passées. Il faut aider le patient à retrouver les évènements traumatiques anciens qui ont déclenché le processus pathologique.
Pendant les dix années suivantes, Freud travaille seul, à partir de son introspection, de son auto-analyse, pour mettre au point la technique psychanalytique basée sur la « libre association des idées ». Celle-ci exige une période de temps suffisamment longue pour permettre aux souvenirs inconscients d’être évoqués. Encore faut-il savoir lire entre les lignes et décrypter le sens des symboles exprimés par le malade, car l’inconscient a son langage particulier : les rêves, les actes manqués, les symptômes psychopathologiques et même les associations d’idées traduisent un sens caché.
En amenant le sujet à retrouver dans son histoire des faits anciens, à les expliquer et à les assumer, et à comprendre les fantasmes qui s’y rattachent, on déclenche un processus de guérison.
Freud réactualise l’introspection : c’est dans la vie intérieure que l’on découvre les secrets de la folie et les moyens de la soigner, selon ce vieux principe que la vérité révélée est curative.
Mais ce qui donne son originalité au traitement psychanalytique, c’est qu’il est basé sur le transfert : Le malade reporte sur la personne du médecin, les sentiments qu’il éprouvait dans le passé à l’égard des gens importants pour lui (surtout ses parents). Il rejoue les situations conflictuelles et revit ses réactions pathologiques, en pouvant alors les aménager, les modifier et y apporter des solutions.
L’analyste l’aide à résoudre les problèmes affectifs qu’il n’a pas pu surmonter dans son enfance.
La guérison suppose donc de vaincre les résistances de la personnalité pour prendre conscience de la signification des symptômes liés à des souvenirs refoulés. La psychanalyse réaffirme ainsi cette conviction, qui a été celle des philosophes grecs, de Cicéron , de St Augustin, de Spinoza, des psychiatres allemands du XIX e siècle et de tous ceux qui, au cours de l’histoire, ont pratiqué la psychologie : l’individu peut trouver, en lui, les capacités de s’auto guérir.
Toute sa vie, Freud est obligé de faire face à des critiques violentes. Son oeuvre est contestée ou même ridiculisée.
D’abord, il ose prétendre que la maladie mentale ne s’explique pas par des lésions organiques, ce qui provoque son discrédit chez les neurologues.
Ensuite, lorsqu’il publie en 1905 « Trois essais sur la théorie de la sexualité », il passe pour un esprit obscène et dangereux .
Il considère que la sexualité ne sert pas seulement à la reproduction, mais qu’elle représente une véritable énergie pour l’inconscient : c’est la libido, la force vitale créatrice. Elle joue un rôle si prédominant que ses troubles sont à l’origine de la plupart des états psychopathologiques.
Les révélations de Freud concernant le contenu de l’inconscient, cette partie cachée de l’être humain faite de sexualité, de perversion, d’instinct animal et de fantasmes scandalisent l’opinion publique.
C’est un peu Sade,qui revient au grand jour, pour rapprocher encore davantage l’être dit « normal » de l’être fou.
Une fois son oeuvre bâtie, en dernier lieu, Freud se consacre à l’étude des problèmes religieux, philosophiques et sociaux. Dans « Totem et tabou » (1913), « L’Avenir d’une illusion » (1927), « Malaise dans la civilisation » (1929), il élargit le champs d’application de la psychanalyse.
Plus qu’une méthode de soins, elle devient aussi une façon de penser, de raisonner et d’expliquer la folie à l’échelle de la société.
Lorsqu’elle entre en France en 1925, la psychanalyse n’apporte pas de changement notoire dans les conditions de vie et le traitement des aliénés. Elle semble s’adresser surtout à des patients ne fréquentant pas l’asile.
Par contre, elle redéfinit cette nécessité de pratiquer une médecine de la personne dans laquelle l’histoire individuelle du patient compte bien davantage que la seule énumération des symptômes.
Et, par l’intermédiaire des universitaires, des psychologues ou des philosophes, elle va permettre aussi à la considération sociale de la maladie mentale d’évoluer.
Dans un début de siècle déchiré par des guerres, agité par une révolution sociale et industrielle, en proie à une insatisfaction grandissante et à un mal de vivre si bien décrits par les écrivains, Freud, malgré les protestations indignées qu’il provoque dans le public, parvient à connaître le succès. Parce que la psychanalyse est aussi une réponse au mal de vivre, elle dévoile le malaise social pour l’appeler maladie.
Elle propose que l’homme devienne responsable de ce qu’il vit, qu’il ait une maîtrise intérieure et qu’il puisse réaliser ses propres désirs, selon son mode de conception personnel, sans attendre que la société ne lui dicte quels doivent être ces désirs.
Elle est cet espoir de rendre l’individu plus libre au niveau de ses dépendances sociales afin qu’il trouve en lui les capacités de donner un sens à son histoire et de construire ses propres régulateurs internes.
« Il faut donner au monde extérieur un sens interne au sein de la réalité psychique, soustraire à la régulation sociale défectueuse des éléments que le Moi pourra articuler par régulation interne ». « Essais de psychanalyse » Freud (1923)
La psychanalyse décrit donc un retour à la philosophie de Platon et de St Augustin, puisqu’elle s’occupe de rebâtir l’espace intérieur, de redécouvrir la conscience de soi, cette sagesse autodidacte garante de l’équilibre psychique.
Réponse à la situation de crise profonde de la fin du XIX e siècle et du début du XX e, la psychanalyse se présente comme l’institution qui peut remplacer toutes les autres défaillantes. Elle satisfait un énorme désir d’autonomisation, de réadaptation et de reconnaissance de la vie intérieure.
« La civilisation moderne a d’abord été une conspiration contre toute espèce de vie intérieure » Bernanos (1945)
Les disciples et les dissidents :
Autour de Freud, assez rapidement, se forme un petit groupe de pionniers : Adler, Rank, Stekel, Jung, Abraham, Ferenczi. Ils partagent tous l’acharnement du maître et parviennent, sans bénéficier encore d’appui universitaire, à créer leur propre cercle scientifique et leur propre presse.
Et Freud s’identifie déjà tellement à son oeuvre, qu’il appelle « la cause », que le destin de celle-ci devient son propre destin.
C’est donc en vivant isolée de la psychiatrie universitaire que la psychanalyse parvient malgré tout, à s’imposer à toute l’Europe, aux USA et en Amérique du sud.
Le premier rassemblement international de psychanalyse a lieu en 1908 à Salzbourg et en 1910 est fondée l’Association Internationale de psychanalyse.
Et au moment même de ce succès, des divergences éclatent au sein des disciples freudiens. Le maître, en chef de bande, pense que la psychanalyse, en tant que science, est inaccessible à la contradiction, et il met systématiquement à distance tous ceux qui osent la contester.
Le mouvement du départ se scinde ; les pionniers, qui sont surtout des théoriciens et non des cliniciens, ne s’accordent plus sur la doctrine. Freud lui-même, emporté par son désir de faire science et de laisser son nom dans l’histoire, est avant tout un chercheur passionné et un écrivain plus qu’un thérapeute. D’ailleurs, il confessera plus tard que :
« La psychanalyse n’est rien d’autre que l’interprétation de ma vocation littéraire en termes de psychologie et de pathologie ».
Adler :
Il exerce sa profession de médecin dans les milieux ouvriers et accorde beaucoup d’importance aux problèmes socio-économiques de l’époque.
Très vite, il constate que les conditions sociales ont une influence considérable sur l’apparition des maladies.
Il rompt avec la théorie freudienne en 1911. Pour lui, l’origine sexuelle des troubles mentaux et des névroses en particulier, n’est pas une explication suffisante. Il pense que ce sont avant tout les sentiments d’infériorité qui entraînent les états psychopathologiques. L’individu a du mal à trouver son identité et à s’affirmer dans la société, et rapidement, il développe ce sentiment de dépendance et d’infériorité.
S’il trouve des compensations, en devenant artiste par exemple, il a une chance de s’en sortir. Mais il peut aussi rester toute sa vie dominé par son complexe qui, inévitablement, se traduira par des perturbations psychiques.
Adler fonde son propre groupe auquel il donne le nom de « psychologie individuelle ».
Jung :
Pourtant bon élève au départ, il se brouille avec Freud au sujet de la théorie de la libido. Cette énergie vitale, pour Jung, n’est pas forcément toujours d’origine sexuelle. Il n’est pas d’accord non plus pour faire remonter tous les troubles psychiques à l’enfance.
En outre la notion d’inconscient freudien lui parait trop limitée.
Il pense qu’il existe aussi un inconscient collectif, riche d’expériences ancestrales, d’images et d’archétypes culturels. Les mythes, les contes, les légendes, les fables, les thèmes littéraires, les créations poétiques, etc... représentent des modes de pensée et forment des bases solides sur lesquelles s’édifient et se structurent les personnalités. Ces symboles sont aussi des armes psychologiques de défense qui permettent une satisfaction imaginaire ou une régulation des conflits inconscients. En cas d’échec et de régression, ils deviennent le langage de la psychose.
Les troubles mentaux prennent naissance dans cet héritage culturel transmis de génération en génération, dans ces produits archaïques qui forment l’inconscient collectif.
Jung considère l’homme avant tout comme un utilisateur de symbole et la composante culturelle, dans son existence, joue donc un rôle essentiel.
Steckel, Rank, Ferenczi :
Ils se séparent aussi de Freud. Ils s’opposent au dogmatisme de la psychanalyse, lui reprochant d’être trop restrictive, de se vouloir universelle et de ne pas tenir assez compte des facteurs culturels et environnementaux.
Influence sur la psychiatrie :
Si la psychanalyse, comme méthode de traitement, ne parvient pas à se faire une place dans le milieu asilaire, elle inspire malgré tout un courant de pensée qui s’oppose aux explications organiques de la folie soutenues par la neurologie.
Même les plus farouches adversaires de Freud ne restent pas complètement imperméables à ses idées.
Et entre les deux guerres, par la force des choses, la psychiatrie prend une orientation qui a beaucoup de points communs avec la psychanalyse. Cette influence va conduire quelques médecins, tels que Bleuler et Meyer, à être à l’origine de changements profonds dans la considération et la prise en charge de la maladie mentale.
Bleuler :
Psychiatre suisse du début du siècle, il se rapproche des idées de Jung et s’en sert pour combattre les théories organiques de Kraepelin concernant l’incurabilité de la démence précoce.
Son expérience acquise au contact des malades l’amène à ne plus considérer tous les psychotiques comme des déments et même à envisager pour certains, une perspective de guérison.
Il tente d’expliquer les symptômes de ces patients en utilisant la méthode dont Freud se servait pour expliquer les névroses. Mais alors que celui-ci avait abandonné les psychotiques à leur sort en les jugeant « inaccessibles à l’influence de la psychanalyse », Bleuler pense que chez eux, on peut aussi essayer de comprendre et d’analyser les processus inconscients, en sachant qu’ils sont bien plus archaïques et éloignés de la réalité que dans la névrose.
Ils représentent une « pensée autistique » primitive qui ne correspond pas à une logique névrotique, mais à une symbolique fantasmatique semblable à celle du rêve. Bleuler décrit les troubles psychotiques en insistant sur l’importance de l’inadaptation et de l’ambivalence amour haine qui caractérisent ces pathologies.
Il donne à la démence précoce le nom de « Schizophrénie », mettant ainsi en valeur le signe principal de l’atteinte psychique qui est la dissociation de la personnalité.
Si Kraepelin reste convaincu que la démence précoce est consécutive à une détérioration du cerveau engendrée par une « métabolite inconnue » qu’il appelle « auto toxine », Bleuler accepte l’idée d’une toxine mais pense qu’elle peut résulter parfois de « complexes psychologiques » qui eux, semblent réversibles dans certains cas de schizophrénie. Il s’accorde ainsi avec l’explication de Jung :
« Les émotions semblent accompagnées de processus chimiques qui causent les troubles ou les lésions temporaires ou chroniques ».
« La psychologie de la démence précoce » Jung.
Bleuler s’affirme comme partisan d’un traitement psychologique des psychoses, traitement qui repose sur l’interprétation du contenu des symptômes. Il abandonne pour un temps la notion de pathologie cérébrale organique, pour rechercher dans l’histoire des patients les évènements qui ont provoqué les troubles. Il constate d’ailleurs que les manifestations psychotiques ne sont que les « caricatures » des processus mentaux des gens normaux.
Mais par la suite, il abandonne la « cause psychologique » et revient à une conception organogénétique des maladies mentales.
Meyer :
Médecin d’origine suisse, il s’installe aux Etats-Unis où, en 1927 il est élu président de l’Association Américaine de Psychiatrie.
Très attentif aux conditions de vie des aliénés, il s’oppose aux traitements classiques et aux explications neurophysiologiques.
Selon lui, le psychiatre, afin de mieux comprendre la maladie mentale, doit prêter beaucoup d’attention à l’histoire du patient et concevoir sa pathologie comme une réponse inadaptée de sa personnalité toute entière à la réalité. L’origine des troubles est donc à rechercher dans le registre social et familial plutôt que dans celui des lésions cérébrales. Mais il n’est pas d’accord non plus pour la limiter au « cloaque supposé de l’inconscient ».
Il juge la psychanalyse bien trop restrictive à ce sujet et pense que de nombreux facteurs, dans l’existence, peuvent être la cause des pathologies.
Les traitements qu’il préconise sont surtout psychologiques, basés avant tout sur l’aide que l’on peut apporter au patient pour qu’il retrouve une adaptation.
Malgré des dissidences importantes parmi ses adeptes, la psychanalyse participe, dès les premières décennies du XX e siècle, à l’histoire de la psychiatrie.
Elle accompagne et soutient ce courant de pensée qui, peu à peu, combattant l’éternel dualisme corps/âme, commence à comprendre que le patient n’est pas qu’un simple cerveau détraqué ou un présentateur de symptômes, mais une unité psycho biologique et sociale.
Même si la technique de traitement psychanalytique reste inappropriée en psychiatrie, la philosophie qui s’en dégage ne peut que contribuer d’une façon bénéfique, à l’évolution et aux changements qui auront lieu par la suite.
-L’existentialisme, expression de la souffrance psychique :
Au sortir de la seconde guerre mondiale, le courant existentialiste qui s’impose, fondé par Kierkegaard et Nietzsche, représente très vite une perspective complètement opposée à celle des organicistes.
C’est un mouvement de révolte contre les valeurs et les convictions acquises. Il traduit les désillusions de cette croyance en une science toute puissante à laquelle on a fait confiance depuis la Renaissance et qui, finalement, a conduit le pays aux catastrophes (Guerres, crises économiques et sociales).
C’est vers la philosophie que l’on se retourne, pour retrouver une certaine sagesse, pour comprendre et pouvoir mieux surmonter les difficultés du monde moderne. L’individu a besoin de se rassurer sur son identité et sur la valeur de sa vie.
La « conscience de soi » représente, pour l’existentialiste, l’unique expérience fondamentale de l’être humain, celle qui reconnaît sa richesse intérieure.
La psychanalyse est donc assez bien acceptée par les philosophies existentielles, puisqu’elle aussi se préoccupe de la réhabilitation et de la reconstruction de soi.
Si l’existentialiste pose la question de l’homme qui se découvre comme « être au monde » et qui doit s’adapter à sa condition humaine, le psychanalyste conçoit la difficulté d’adaptation comme pathologique, mais tout deux ont une attitude commune par rapport à celui qui souffre : ll faut s’intéresser au sujet lui-même, à son histoire personnelle, à son propre univers intérieur et non pas seulement à ses symptômes.
De nombreux psychiatres, assez peu influencés par la psychanalyse, se laissent séduire par la philosophie existentielle et trouvent en elle une alliée pour s’opposer aux théories organicistes de la folie.
D’autres, d’esprit plus analytique, comme Jacques Lacan et Henry Ey saisissent l’occasion pour démontrer la « causalité psychique des troubles mentaux » :
« Loin donc que la folie soit le fait des fragilités de l’organisme de l’homme, elle est la virtualité permanente d’une faille ouverte dans son essence ».
Lacan, « conférences de Bonneval » 1946
L’existentialisme et la psychanalyse se rejoignent donc pour parler de la folie : elle est autre chose que cette « maladie des organes du cerveau », elle traduit un problème d’intériorité, de subjectivité par lequel l’individu exprime ses difficultés d’adaptation.
Mais la psychiatrie des années 50, qui n’existe encore qu’à travers la neurologie et qui confond allègrement maladie psychique et maladie du système nerveux, a bien du mal à accepter ce nouveau langage. A l’université de Paris, le service d’enseignement de la psychiatrie porte le nom significatif de « Clinique des maladies mentales et de l’encéphale »; on y étudie la physiopathologie avec un rationalisme médical parfaitement anti-freudien.
C’est encore une fois la philosophie qui amène un véritable changement dans la façon de comprendre les comportements humains et la souffrance psychique. Avec plus de réalisme que la psychanalyse, elle décrit l’expérience de la folie comme une expérience humaine, existentielle, dans l’ordre des choses, qui n’est plus seulement celle de l’aliéné, derrière les murs de l’asile, mais qui peut un jour concerner n’importe qui. C’est réellement dans la condition humaine que d’être désespéré :
« Ce qui est rare, ce n’est pas d’être désespéré, au contraire, le rare, c’est de ne pas l’être ».
« Traité du désespoir », Kierkegaard (1849)
Naissant de cette constatation, les philosophies existentielles veulent considérer l’existence humaine dans sa réalité terrestre, à partir de l’expérience vécue et, pour ce faire, elles rejettent les explications mystico idéalistes :
« Dieu est mort » dit Nietzsche, et l’homme peut enfin se réconcilier avec sa vraie nature, avec sa propre intériorité d’être humain confronté à une vie qui est faite de faiblesses, de doutes, de souffrance et de désespoir.
Ce ne sont plus la religion, la science positiviste ou la raison qui doivent expliquer les phénomènes humains. La réflexion philosophique seule peut donner un sens à l’existence car elle le puise dans la réalité, là où se déroulent les vrais combats. Les atrocités de la guerre, les perversions de l’idéologie nazie, les crises économiques et sociales, l’agonie des malades mentaux dans les asiles, jettent à bas toutes les valeurs morales, ces garde-fous qui jusque là devaient préserver la destinée humaine de sa déraison.
« Dieu est mort »! Mais cette liberté peut bien devenir une source d’angoisse, un « Enfer », car l’homme y perd ses références et ses identifications. Il ne trouve plus nulle part de signes lui révélant ce qu’il doit croire ou faire. En dehors de lui, il y a ce monde hostile, cruel, impénétrable et au dedans, une absence, un vide, un néant qui se traduisent par une souffrance psychique, une aliénation. Il devient un « étranger », étranger à sa propre vie.
Projeté dans l’existence, en tant qu’acteur et témoin, il doit assumer sa vie, se faire, se créer, devenir :
« L’ homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait ».
« L’existentialisme est un humanisme », Sartre (1946).
Désormais, il lui faut construire son propre projet, rechercher sa vérité en lui-même, sans attendre qu’elle ne lui soit dictée par des instances supérieures auxquelles d’ailleurs il n’accorde plus sa confiance.
Responsable de lui-même, il doit retrouver cette « conscience de soi » organisatrice. C’est dans la richesse de sa vie intérieure qu’il découvre sa valeur d’être humain.
La philosophie existentielle, s’écartant à tout jamais des sentiers de la métaphysique, décrit la réalité de la vie faite d’absurde, d’ennui, d’angoisse et de folie. Ainsi se fait jour la nécessité de repenser les relations humaines, de modifier l’image que l’homme se construit de lui-même, de revoir les concepts de normalité et de déviance, d’objectivité et de subjectivité, de santé et de maladie.
L’expérience de la folie, finalement, caractérise bien l’expérience humaine, elle en est même si proche qu’elle en fait partie. On redécouvre, grâce à elle, l’importance que l’on doit accorder à la vie intérieure, point de rencontre de la philosophie, de la psychanalyse.
La souffrance psychique n’est plus limitée par les murs de l’asile, elle est reconnue comme une possibilité humaine et, dans l’après-guerre, devient une menace sociale qui s’exprime en termes de « désadaptation », d’ « angoisse de vivre », de « mal dans sa peau » ou de « sentiment d’étrangeté du monde ».
Le devenir social, face au danger de la folie, sera alors une des préoccupations importantes de la future psychiatrie .
3
LES THERAPEUTIQUES DE LA FOLIE
Dès le début du XX e siècle, l’institution asilaire fait l’objet d’une remise en question.
On constate que l’on a abandonné complètement la notion de « traitement moral », que l’asile ressemble davantage à une prison qu’à un lieu de soins et que trop souvent, le nombre de décès l’emporte sur celui des guérisons.
L’expérience de St Alban apporte la preuve que la maladie mentale peut être traitée autrement. Et certains s’en servent pour réaliser une critique de l’État actuel de la psychiatrie :
La vie asilaire est faite de dissimulation. Les patients sont amenés à refouler et à cacher leurs troubles au profit d’une adaptation factice aux conditions de détention. Il ne s’agit plus d’un « traitement moral » mais d’un véritable « conditionnement » qui contraint la psychose, non pas à s’améliorer, mais à évoluer dans le sens déficitaire pour devenir une maladie institutionnelle. L’asile, loin de guérir, conduit à la chronicité qui se manifeste par une perte d’initiative, un désintérêt progressif et une docilité apathique.
Et les patients, qui finissent par sombrer dans un abrutissement institutionnel, n’ont pas d’autre issue que de terminer leur vie derrière des murs.
Toutefois, il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour assister à un changement radical de cette pratique psychiatrique. Pour le moment, même si quelques idées nouvelles sont avancées, on conserve des habitudes thérapeutiques bien archaïque
-La pauvreté des anciennes médications :
On calme l’agitation avec des bromures, du chloral, de l’opium ou du laudanum. Les premiers barbituriques font leur apparition. Les bromures de potassium, découverts en 1826, sont utilisés dans l’épilepsie, l’hystérie, l’excitation maladive de l’appareil génital, les convulsions, la disposition aux « attaques des nerfs ».
Le sirop de chloral, découvert en 1870, fait dormir ; on le donne en cuillerées ou en lavements.
L’opium et le laudanum (opium liquide) se prennent en tisanes, en lavements ou même en décoctions de pavot. Réservés surtout aux cas d’agitation, on les prescrit aussi dans la mélancolie et l’anxiété.
Pour combattre l’insomnie et l’excitation, on dispose de la scopolamine et de quelques barbituriques.
La scopolamine est extraite du mandragore, cette plante aux mille vertus, célèbre depuis l’Antiquité, notamment pour ses pouvoirs en sorcellerie.
Parfois sont prescrits des somnifères et des anesthésiques de la série Gardénal, Véronal, Nembutal, Ortenal, Binoctal, etc... élaborés à partir de l’acide barbiturique découvert le jour de la Santa-Barbara en 1903.
Le Serpentaire ou Rauwolfia ou « herbe aux fous », plus connue sous les noms de Réserpine et Sarpagon, est aussi utilisée après 1930, ainsi que des amphétamines telles que Captagon, Maxiton, Fringanor, Ordinator, qui ont servi pendant la guerre à accroître la vigilance des pilotes d’avions.
Mais l’usage de toutes ces drogues reste bien limité en raison des risques importants d’intoxication et de toxicomanie qu’elles peuvent entraîner.
Alors, faute de mieux, on a recours très souvent aux méthodes plus classiques de la camisole et de l’hydrothérapie.
Et, lorsque après la guerre, on commence à critiquer les institutions asilaires, à dénoncer la chronicité et les mauvais traitements, les psychiatres restent toujours autant désarmés devant la folie qui se trouve au dessus des possibilités d’action thérapeutiques de l’époque. Non seulement on ne sait pas soigner ou guérir, mais on a énormément du mal à venir à bout des agitations.
C’est par la force des choses, pour changer cet état de fait, que l’on va s’efforcer de mettre au point et d’une façon tout à fait empirique, des « thérapeutiques de chocs ».
-Les thérapeutiques de chocs :
La malaria thérapie :
Le neurologue autrichien Von Jauregg, en observant les déments syphilitiques, fait la constatation suivante : l’état mental des patients parait s’améliorer lorsqu’ils présentent des infections accompagnées de forte fièvre. Il en déduit donc que la fièvre peut agir comme un calmant de la folie.
En suivant ce principe, il décide d’inoculer le paludisme à ses malades syphilitiques. Et l’expérience semble apporter confirmation à son hypothèse de départ.
La technique est simple : on prélève du sang chez un paludéen en crise, que l’on injecte à un syphilitique. Celui-ci présente, après 10 à 12 accès de fièvre, une amélioration des délires et des excitations dans 30% des cas. Il est facile ensuite, d’enrayer l’impaludation par de la quinine.
Jauregg reçoit le prix Nobel pour son invention en 1927.
Il sera le seul psychiatre à mériter cette distinction.
La cure de Sakel :
L’insuline, découverte depuis 1922 est surtout utilisée dans le traitement du diabète. On s’en sert aussi parfois pour stimuler l’appétit des malades mentaux anorexiques et on constate qu’à petite dose, elle semble aussi calmer l’agitation.
Sakel, médecin psychiatre autrichien, décide alors, pour la première fois, de la prescrire pour ses propriétés sédatives.
Et c’est une erreur de manipulation qui va permettre à l’insuline de devenir un traitement biologique de la schizophrénie.
Ayant administré une trop forte dose à l’un de ses patients, Sakel s’aperçoit qu’après une période de coma profond, le sujet présente une nette amélioration de son état mental.
Il préconise donc, suite à cet essai involontaire, de pratiquer une insulinothérapie à doses élevées.
On ignore encore aujourd’hui le mode d’action réelle de ce genre de traitement. On avance l’hypothèse que l’hypoglycémie, en diminuant la quantité de sucre et d’oxygène dans le sang, favoriserait une réduction de l’activité cérébrale, et par conséquent celle aussi de l’agitation, des délires et des hallucinations.
En outre, au sortir du coma, le malade se trouve dans un état de régression psychophysiologique profonde qui nécessite, de la part de son entourage, un maternage important. Et cette prise en charge dont il fait l’objet ne peut être que bénéfique pour sa schizophrénie.
Mais l’insulinothérapie présente des risques énormes de troubles respiratoires et cardiaques ou de coma irréversible. Pour ces raisons, elle sera abandonnée dans les années 40.
Le choc cardiazolique :
Méduna, médecin psychiatre à Budapest, acquiert la conviction, au cours de son expérience professionnelle, que l’épilepsie et la schizophrénie sont deux maladies incompatibles. Il pense même que c’est une chance pour un schizophrène que de devenir épileptique, puisque enfin il verra sa schizophrénie disparaître.
En 1933, il met donc au point un nouveau traitement qui consiste en l’administration de produits convulsivants à ses patients. Il essaye d’abord le camphre, puis ensuite le cardiazol.
Les crises d’épilepsies qu’il provoque sont réalisées sans anesthésie préalable, elles sont intenses, brutales et entraînent souvent des fractures. Les malades s’agitent et s’angoissent énormément durant le temps d’attente nécessaire entre l’injection et l’action du produit. On peut même se demander si ce n’est pas surtout la peur qui, dans ce genre de traitement, présente des vertus thérapeutiques.
L’électrochoc :
L’utilisation de l’électricité dans le traitement des maladies mentales est assez ancienne puisqu’elle remonte à 47 après JC.
A cette époque là, on se servait d’anguilles électriques qui, placées sur la tête des patients, provoquaient des décharges curatives.
Au cours du XIX e siècle, on constata aussi que des électrocutions accidentelles entraînaient souvent des crises convulsivantes.
Mais c’est à l’italien Cerletti que revient le mérite d’avoir remplacé le choc cardiazolique par une stimulation électrique.
Après avoir essayé sa « technique d’ « électrochocs » sur des porcs destinés à l’abattoir, il réalise en 1938 la première expérience sur un schizophrène.
Moins onéreux et moins dangereux que le cardiazol, l’électrochoc a rapidement du succès.
Efficace semble-t-il pour améliorer certaines psychoses et surtout les dépressions mélancoliques, on l’utilise aussi fréquemment dans les états d’agitation.
Le courant électrique envoyé sur les tempes du malade par deux électrodes métalliques est de 70 à 130 volts pendant un temps court ( de un dixième à cinq dixièmes de seconde). Les séances sont au nombre de trois par semaines en général, pour une cure de cinq à trente-cinq semaines.
Ce traitement est réalisé sans anesthésie. Les malades s’y présentent dans un état d’appréhension épouvantable.
Par la suite, la technique est améliorée sous le terme déguisé d’ « électronarcose ». Le patient est préalablement endormi par du penthotal et curarisé afin qu’une relaxation musculaire suffisante puisse éviter les fractures.
L’électrochoc agit en modifiant la production et la distribution de ces substances chimiques appelées « neuromédiateurs ». Il crée artificiellement une période de calme, une « rupture » dans l’évolution de la maladie qui se manifeste par une amnésie passagère durant laquelle le patient « oublie » peut être les évènements qui ont provoqué sa psychose. Mais cette période de rémission des symptômes reste passagère et il est nécessaire de recommencer le traitement.
La lobotomie :
Les fouilles anthropologiques d’Afrique et d’Amérique latine ont rapporté des centaines d’exemples d’ouverture du crâne. La trépanation parait être l’une des plus anciennes opérations pratiquées chez l’homme. S’agissait-il d’un rite sacré pour chasser les « mauvais esprits » ou enlever la « pierre de la folie » ?
En tout cas, le XX e siècle devait aussi connaître à son tour, son heure de neurochirurgie.
C’est Morniz, neurologue à Lisbonne pendant la deuxième guerre mondiale, qui est le premier à pratiquer, par la « lobotomie », un geste opératoire destiné à supprimer la pensée anormale.
Morniz déduit de l’observation des obsessionnels et des mélancoliques que ces malades ont un cercle vicieux d’idées morbides et malsaines qui tournent en rond et qui paralysent toute leur activité cérébrale.
Selon lui , ces idées se localisent au niveau préfrontal qui semble être aussi le siège de l’agressivité.
Des expériences, effectuées sur des singes, permettent alors de constater que les animaux se montrent en général plus dociles après avoir subis une section des fibres des lobes préfrontaux.
Chez l’homme, dans les cas de tumeurs cérébrales ayant nécessité l’ablation de ces mêmes lobes, on note aussi une réelle amélioration de l’humeur.
C’est en 1935 que Morniz décide de pratiquer ses premières lobotomies sur des malades mentaux. Rapidement, cette psychochirurgie suscite un grand intérêt . On pense avoir enfin trouvé un moyen en psychiatrie, d’agir efficacement sur l’agitation, dans les cas de psychoses résistantes aux électrochocs.
Enlever la folie par un simple geste opératoire, on en rêvait depuis longtemps !
L’intervention, malgré la crainte qu’elle inspire, n’entraîne le décès que dans 1 à 2% des cas. Et dans les années 40-50, beaucoup de malades sont lobotomisés, même si les résultats, dans l’ensemble, restent discutables.
Rares sont ceux qui s’en trouvent « améliorés » par une réduction de leur agressivité, sans être devenus des « « légumes placides ».
Par contre, c’est une menace pour tous les pensionnaires que de devoir subir ce « labourage de cerveau », qui mutile physiquement et qui laisse des cicatrices :
Après une simple anesthésie locale, on pratique deux trous symétriques au dessus et en avant de chaque oreille afin d’y passer les trépans et d’atteindre la région lobo frontale et le thalamus.
La trajectoire du trépans est calculée de façon théorique. Bien souvent, on lui fait faire une translation approximative suivant un angle de 45° pour s’assurer d’un bon labourage.
-Les traitements psycho pharmacologiques :
Le 19 septembre 1950 a lieu à Paris le premier congrès mondial de psychiatrie. Quatorze pays y sont représentés. On y expose fièrement les nouvelles techniques de traitement des maladies mentales et on se félicite des résultats obtenus.
Le couteau à lobotomie et l’appareil à électrochocs font sensation, même s’ils évoquent par certains côtés les salles de torture de l’Inquisition.
La psychanalyse, dans son coin, est loin de susciter autant d’intérêt et de curiosité.
Nées d’une volonté de changer l’asile, les thérapeutiques de chocs ont surtout cherché à réduire la violence et l’agitation, sans pouvoir apporter un soin réel à la folie, ni une amélioration notable des conditions de vie des aliénés, bien au contraire car c’est toujours la peur, celle de subir des réprimandes, des sanctions ou des traitements traumatisants, qui règne à l’hôpital et l’obligation inéluctable de finir sa vie derrière des barreaux.
Pendant ce temps, des milliers de pages de nosographie sont rédigées par Bleuler, Dupré, Ballet, Janet, etc... Elles resteront sans conséquence sur l’avenir des malades mentaux.
Pourtant, à partir de 1952, et durant les dix années suivantes, un changement arrive, d’une façon imprévisible et involontaire. Quelques psychiatres et chimistes, tels que Charpentier, Laborit, Denicker et Delay, unissant leurs efforts, vont parvenir, grâce à la psychopharmacologie, à transformer le visage de l’asile.
Mais leurs découvertes ne s’appuient sur aucun raisonnement scientifique. C’est avec beaucoup de hasard et d’empirisme et surtout une passion obstinée pour la recherche, qu’ils vont permettre à des molécules chimiques de devenir les médicaments spécifiques de la folie.
Et la véritable rupture avec la tradition asilaire peut enfin s’amorcer.
On ne la doit pas à une prise de conscience des soignants ou à une évolution soudaine de leur façon de comprendre la maladie mentale. Si la contrainte, l’enfermement et la peur laissent peu à peu la place à une autre psychiatrie, c’est parce que le médicament parvient à amener un changement du côté du malade, en le rendant capable d’accéder à une rencontre thérapeutique.
Cette constatation engagera alors les soignants dans une réflexion sur le soin.
Les neuroleptiques :
Au départ, l’objet de la recherche ne concerne pas du tout un produit capable d’agir sur le psychisme.
Effectivement, l’histoire de la découverte du premier neuroleptique commence étrangement par celles de l’Antergan et du Néo-antergan, des antihistaminiques qui, associés aux cocktails anesthésiants, permettent d’éviter le choc opératoire tant redouté lors des interventions chirurgicales.
Mais ces antihistaminiques présentent l’inconvénient majeur d’être très sédatifs. Et cet effet secondaire, à ce moment là, ne mérite aucune attention particulière.
Durant la guerre, la nécessité de lutter contre le paludisme oriente la recherche dans une autre direction. On retravaille sur une ancienne molécule - la phénothiazine - utilisée comme insecticide en 1934 et comme antiparasitaire en 1938. Et les chimistes de Rhône Poulenc lui découvrent des dérivés ayant une action antihistaminique : le Diparcol et le Phénergan, qui lui, semble être aussi très sédatif.
C’est alors que l’on va délaisser volontairement le côté antihistaminique pour s’intéresser uniquement au côté sédatif.
A partir du Phénergan, le chimiste Charpentier élabore un produit plus puissant, dépourvu d’action antihistaminique, qu’il nomme : Chlorpromazine. Il s’avère être un stabilisateur neurovégétatif, un antispasmodique très sédatif qui renforce l’action des hypnotiques, des anesthésiques et des barbituriques.
Il reste alors à lui trouver des indications :
On pense à la chirurgie, bien sur, puisqu’il provoque une hibernation artificielle par abaissement de la température et qu’il potentialise les anesthésiques.
On le teste ensuite en psychiatrie où il se montre bénéfique dans les cures de sommeil, dans le traitement des crises maniaques et des états schizophréniques. Son action est efficace et rapide à doses élevées sur les délires, les hallucinations et les agitations.
Il permet au patient de retrouver une certaine « lucidité » et d’améliorer son contact avec le soignant.
Baptisée Largactil en 1952, la chlorpromazine devient le chef de file d’une nouvelle série : les neuroleptiques.
L’aliéné devient alors définitivement un malade mental, puisqu’il existe maintenant un médicament adapté à sa maladie. Et le psychiatre définit mieux son rôle de médecin en pouvant prescrire un produit ayant une action sur la folie.
Les laboratoires, quant à eux, réalisent très vite l’intérêt commercial d’une telle découverte. Le but lucratif, stimulant principal de la recherche, va favoriser l’apparition de nouveaux médicaments.
Les antidépresseurs :
Si le Largactil permet désormais d’agir sur les délires et les hallucinations, d’autres symptômes, en psychiatrie, réclament aussi un traitement spécifique.
On a tout essayé, par exemple, pour venir à bout d’une des plus grandes maladies de l’asile, tour à tour appelée « humeur noire », dépression, mélancolie, folie circulaire ou psychose maniaco-dépressive.
Les électrochocs, les cures d’opium, les narcoses aux barbituriques, les injections de testostérone, les inhalations d’oxyde d’azote ou les irradiations aux rayons X se sont soldés par des résultats médiocres.
Après avoir permis la découverte des neuroleptiques, c’est encore le hasard, qui va entraîner celle des antidépresseurs.
En 1951, malgré l’arrivée des antibiotiques, la tuberculose reste toujours un fléau redoutable.
Les laboratoires Hoffman Laroche, aux USA, décident de se lancer dans la recherche de remèdes plus efficaces.
A partir de l’Hydrazine, une substance chimique utilisée comme carburant pendant la guerre, ils synthétisent deux médicaments : le Marsilid et le Rimifon. Si l’action de ces produits sur les lésions tuberculeuses parait discutable, ils semblent avoir, par contre, des effets secondaires insolites sur le psychisme : effectivement, les malades pourtant au seuil de la mort, retrouvent le sourire et se montrent euphoriques.
En 1956, le psychiatre américain Nathan Kline tente alors de prescrire le Marsilid uniquement pour ses effets secondaires, dans les cas de dépressions. Et comme ses essais sont concluants, il rencontre les chimistes de la firme Hoffman Laroche pour les convaincre de fabriquer le produit.
Cette situation unique, d’un psychiatre qui démarche auprès d’un laboratoire, n’aura plus jamais l’occasion de se reproduire par la suite.
Le Marsilid, qui agit en inhibant une enzyme cérébrale - la mono-amine-oxydase - devient, pour cette raison, le chef de file des IMAO ( inhibiteurs de la mono-amine-oxydase).
Mais rapidement, un autre groupe d’antidépresseurs vient détrôner les IMAO. Le premier de cette série est découvert d’une façon encore tout à fait fortuite, par le psychiatre suisse Khun.
En collaboration avec les laboratoires Geigy, il travaille alors sur l’Imipramine, un dérivé très sédatif de la Chlorpromazine, dans l’intention de trouver un hypnotique.
Le hasard fait qu’il le prescrit à des malades dépressifs. En prolongeant l’expérience, il s’aperçoit que l’on peut obtenir des résultats encourageants en osant administrer le produit sur des périodes longues de plusieurs semaines.
Les patients auparavant angoissés, prostrés, moroses, deviennent peu à peu bavards, actifs et cherchent à renouer des relations avec leur entourage.
Le médicament parait n’agir que sur la dépression.
Aucun raisonnement scientifique, là non plus, n’est à l’origine de cette découverte, qui résulte simplement de l’empirisme et de la détermination d’un psychiatre.
L’Imipramine est commercialisée en 1958 sous le nom de Tofranil et devient le premier antidépresseur tricyclique ( parce que la molécule de base possède trois anneaux)
Les IMAO, jugés trop dangereux pour leurs effets secondaires (hépatites mortelles, hypertension ou hémorragies cérébrales), sont retirés du marché dès 1961.
Le lithium :
A l’usage, on constate qu’il faut émettre des réserves quant aux indications et aux possibilités d’action thérapeutique des anti-dépresseurs. Ils redressent parfois trop bien les dérèglements de l’humeur, au point de provoquer un passage à un état euphorique et maniaque.
D’autre part, ils se montrent souvent inefficaces pour enrayer les rechutes en cas de psychose maniaco-dépressive.
C’est encore le hasard qui va favoriser la découverte d’un produit préventif des rechutes, qui soit aussi un véritable régulateur de l’humeur, ce que ne sont pas les antidépresseurs. En 1949, un psychiatre australien nommé John Cade, avait effectué des recherches en laboratoire sur les propriétés de l’acide urique. Et, voulant diminuer la toxicité de l’urée, il avait élaboré un « urate de lithium », solvant de l’acide urique.
C’est en l’administrant à des cobayes et à des rats, qu’il se rendit compte que le produit les calmait et les apaisait sans réduire leur état de conscience. Expérimenté ensuite sur des patients, il permettait à des états d’excitation maniaque avec agitation de régresser en une semaine.
Mais le lithium devait être délaissé en raison des risques de complications toxiques qu’il comportait. Et puis John Cade était un psychiatre trop peu connu. Les firmes pharmaceutiques s’intéressaient bien davantage, à ce moment-là, aux molécules des neuroleptiques et des antidépresseurs qu’aux vertus de cet étrange métal.
C’est alors qu’un médecin danois Mogen Schou, reprend avec entêtement les recherches de Cade. Il parvient à prouver l’innocuité et l’efficacité du produit lorsque son utilisation est subordonnée à des contrôles réguliers des concentrations sanguines.
Mais le lithium a encore bien du mal à s’imposer sur le marché des produits pharmaceutiques. Il ne présente peut être pas des intérêts commerciaux et financiers suffisants.
Même en étant un bon traitement curatif des états maniaques et surtout préventif des rechutes en cas de psychose maniaco-dépressive, on ne peut pas le considérer vraiment comme un médicament. C’est un ion, présent naturellement dans l’organisme, au même titre que le sodium ou le potassium, et son mécanisme d’action, bien que prouvé, n’a jamais vraiment été élucidé.
Les tranquillisants :
L’histoire de la découverte du tranquillisant, liée elle aussi au hasard et à l’empirisme, représente encore un bel exemple d’une recherche menée sans aucune présupposition quant à l’activité biologique du médicament.
Alors que l’on s’évertue dans les laboratoires à trouver des successeurs aux premiers neuroleptiques, et si possible plus efficaces, le chimiste Léo Sternbach, en 1954, décide de remettre à l’étude des produits anciens appelés : benzheptoxdiazines. Il est persuadé que ces composés, utilisés dans la fabrication de colorants chimiques, possèdent des propriétés intéressantes.
Sternbach les synthétise, les modifie et tente finalement de les proposer à la firme Hoffmann Laroche, afin qu’ils soient testés.
Mais il se heurte à un refus. Ses produits n’ont pas d’action biologique exploitable et provoquent des convulsions.
Il se voit donc dans l’obligation d’arrêter ses recherches.
Quelques années plus tard, en 1957, lors d’un nettoyage du laboratoire, Sternbach retrouve dans un coin une fiole rescapée du programme abandonné. Afin d’achever définitivement la série, et d’en tirer une publication de chimie, il la renvoie à l’épreuve du test.
Et, contre toute attente, cette fois-ci, le produit se révèle très intéressant, capable même de rivaliser avec la chlorpromazine.
On lui trouve d’étonnantes propriétés sédatives et relaxantes, il semble peu toxique et dénué d’effets indésirables sur le système nerveux autonome.
La firme Hoffmann Laroche demande à Sternbach d’en synthétiser davantage et c’est à ce moment-là qu’il se rend compte de son erreur : le produit en question n’a rien à voir avec les benzoheptoxdiazines du départ, il a une classe chimique différente certainement due à un accident de manipulation. La molécule de base avait incorporé un nouvel atome de carbone pour donner naissance à une « benzodiazépine ».
Les tests pratiqués sur les animaux confirment l’intérêt du produit : il apprivoise les chats sauvages et domestique sans les endormir des singes macaques particulièrement agressifs.
On passe ensuite à des essais sur l’homme, en adaptant les dosages. C’est la réussite, les psychiatres en redemandent.
Le nouveau médicament calme l’anxiété, soulage les tensions nerveuses sans entraîner d’effet secondaire gênant.
Il est commercialisé en 1960 sous le nom de Librium et en 1963, le Valium, plus connu, lui emboîte le pas.
Une fois lancés sur le marché, les tranquillisants connaissent un succès inégalé. Ils répondent à une demande urgente et insatiable qui dépasse largement les murs de l’asile : soulager l’angoisse et le mal de vivre des gens « normaux ».
A partir de 1963, le Valium devient le médicament le plus prescrit et le plus consommé aux USA. Il le restera pendant douze ans.
C’est le hasard surtout, et non pas une volonté consciente de soulager la souffrance psychique ou d’agir sur la folie, qui a permis à certaines molécules de révéler quelques particularités à « soigner » les maux de l’esprit.
La psychopharmacologie et la neurochimie n’existent finalement que grâce à un Largactil bricolé à partir de molécules antihistaminiques, à un Tofranil dérivé de remèdes antituberculeux et à un Librium issu d’une erreur de manipulation.
Ensuite, par le travail assidu des chimistes et des psychiatres qui ont su collaborer, ce hasard a répondu à une nécessité.
Ces premiers médicaments du cerveau, qui sont à l’origine d’une prochaine révolution dans la pratique psychiatrique, révèlent aussi l’existence de la souffrance psychique au delà des limites de la pathologie mentale.
L’individu « normal » peut alors revendiquer le droit d’exprimer et de soigner aussi son « mal être intérieur », cette impression de malaise subjectif fait d’angoisse et de dépression qui justifie sa consommation de drogues psychotropes.
Et les firmes pharmaceutiques s’en réjouissent. Rapidement éblouies par leur essor prodigieux et sans plus apprécier les limites de ces traitements chimiques, elles vont apporter une remise en question de la clinique et établir de nouvelles classes diagnostiques.
L’illusion de guérir ou d’ « enlever » la folie et de supprimer le mal de vivre s’imposera à tel point que l’on ne s’occupera bientôt plus que du symptôme, négligeant cette maladie dont on ignore toujours les causes.
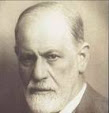
1 commentaire:
Je trouve quelque chose en phytothérapie bon à partager ici avec toute personne souffrant de la maladie comme le VIH, l'herpès, l'hépatite ou la maladie de Lyme chronique, la maladie de Parkinson, la schizophrénie, le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer colo-rectal, le cancer du sang, le cancer de la prostate , siva.Fatal Insomnie Familiale Facteur V Leiden Mutation, Épilepsie Maladie de Dupuytren, Tumeur Desmoplasique À Petites Cellules Rondes Diabète, Maladie Cœliaque, Maladie de Creutzfeldt-Jakob, Angiopathie Amyloïde Cérébrale, Ataxie, Arthrite, Scoliose Amyotrophique Latérale Latérale, Foribromyalgie ProgresS sclérose, crises d'épilepsie, maladie d'Alzheimer, carcinome corticosurrénalien, asthme, maladies allergiques, VIH, sida, herpès, copd, glaucome., Cataractes, dégénérescence maculaire, maladie cardiovasculaire, maladie pulmonaire, hypertrophie de la prostate, ostéoporose, maladie d'Alzheimer,
Démence.
Lupus aussi.Dr Itua herbal a fait guérir mon VIH et m'a donné l'espoir qu'il peut guérir tous les types de maladies je le croyais) Je fais de mon mieux que je peux faire, je suis allé pour un programme en Afrique de l'Ouest sur la mode sur un autre côté j'étais séropositif. Je marche dans un village voisin pour consulter notre programme, puis j'ai trouvé un avis de signalisation indiquant Dr Itua Herbal Center puis j'ai demandé à mes collègues ce qu'il en était de cet homme appelé Dr Itua, elle m'a dit qu'il était un phytothérapeute et qu'il pouvait tout guérir sorte de maladie je suis allé vers lui et je me suis expliqué à lui comme je suis un étrangleur là-bas, il m'a préparé des plantes médicinales et m'a dit comment le boire pendant deux semaines, quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel, je le regarde alors dit une prière avant de la boire sans le savoir après deux semaines, je suis allé faire un test et j'ai découvert que j'étais négatif, je me suis précipité vers lui pour le payer plus mais il refuse et dit que je devrais partager ses œuvres pour moi dans le monde entier afin que les personnes malades puissent voir aussi. J'écris beaucoup sur lui cette saison, c'est ainsi que j'ai été guéri en buvant la phytothérapie du Dr Itua, c'est un homme attentionné avec un cœur pieux. Eh bien - tout ce que j'ai décidé est passé pour moi et comment vous allez traiter ce nouvel aspect de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de souffrir seul et vous pouvez demander de l'aide. Il n'est pas nécessaire non plus que ce soit un démon constant, car vous apprendrez à connaître votre corps et vous-même d'une manière beaucoup plus profonde que la plupart des gens. Profitez-en, car cela vous aidera à apprécier Africa Herbal Made.
Coordonnées du Dr Itua.
Email ... drituaherbalcenter@gmail.com Numéro Whatsapp .... + 2348149277967
Enregistrer un commentaire