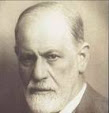LA RENAISSANCE :
L’HUMANISME CONTRE LES SUPERSTITIONS
Délivrée de la guerre de Cent ans, la France connaît un essor économique marqué par la croissance urbaine, le développement du commerce, de l’industrie et de la presse d’imprimerie.
Le déclin de la féodalité et du clergé font de la Renaissance une période de transition, de remise en question.
Un esprit de recherche tente, peu à peu, d’échapper au poids des lourdes institutions et des idées médiévales erronées.
Les astronomes dénoncent les anciennes conceptions de l’univers, les anatomistes, s’engageant dans la découverte du corps humain, contestent les théories galéniques.
La science et la pensée veulent faire confiance à l’expérience et aux sensations, sans se référer à une autorité.
Les premiers humanistes, tels que Brant, Erasme, Rabelais, Machiavel ou Montaigne, suscitent un mouvement qui s’écarte des doctrines rigides de l’époque pour retrouver la philosophie de l’Antiquité. L’étude des classiques redevient à la mode et permet aux humanistes de combattre les superstitions et l’obscurantisme médiéval.
Mais si cet esprit nouveau essaye de décrire la réalité de façon plus objective, il ne réussit pas à chasser complètement les explications démoniaques de la folie.
La Renaissance reste cette période la plus marquée par l’Inquisition et nombreux sont les fous, les hérétiques et les sorcières qui brûlent encore sur les bûchers.
1
PRATIQUES MAGIQUES ET SUPERSTITIONS
Les médecins, pour la plupart, restent très attachés aux superstitions. Ils sont convaincus que les trois affections de la tête alors reconnues : frénésie, manie et mélancolie - s’expliquent par une perturbation des humeurs ou un changement de la bile dés à des influences démoniaques.
Et la thérapeutique applique jusqu’à l’absurde, le principe galénique du traitement par les contraires :
La frénésie est un échauffement des méninges, il faut donc refroidir.
La mélancolie correspond à une surcharge d’atrabile qu’il est nécessaire d’évacuer par des purges, des saignées, des vésicatoires, etc .
L’épilepsie provient d’un engorgement dé à la pituite, ce venin fabriqué par les diables et les démons, et il faut dessécher .
Les maladies de l’esprit sont toujours considérées comme la conséquence du péché et de l’immoralité.
Félix Plater, professeur de médecine, auteur de « praxis medica », explique que les fantasmes sexuels, qui souvent conduisent à la folie, résultent d’une possession par le diable ou d’un châtiment divin.
On s’en tient donc à la bile noire, aux anges déchus attirés dans le corps, aux forces surnaturelles et aux envoûtements pour trouver la cause des troubles mentaux.
La magie et la superstition continuent d’exercer leur influence, même si la Renaissance connaît de réels progrès scientifiques. Alors que l’astronomie révèle des vérités concernant le mouvement des planètes, parallèlement se développe l’astrologie, science de la prédiction .
Même Kepler, qui devient célèbre à partir de 1609 pour ses fameuses Lois d’astrophysique, établit volontiers des horoscopes .
Rabelais, pourtant farouche adversaire du charlatanisme, s’adonne aussi à cette pratique et se fait appeler : professeur d’astrologie.
L’Eglise, qui condamne cette science divinatoire, ne peut empêcher ses papes, d’aller en cachette, consulter des astrologues. Aujourd’hui, nos chefs d’état ont tous, et c’est connu, des consultations de ce type .
Toute civilisation utilise des pratiques magiques. Les découvertes rationnelles suscitent toujours des forces opposées irrationnelles, parce que la science ne suffit pas, à elle seule, à satisfaire le rêve. C’est comme si le « trop savoir » mettait en péril l’âme et son besoin perpétuel d’inexpliqué La Renaissance n’échappe pas à cette règle. Pourtant enthousiasmée par les découvertes scientifiques, elle est attirée aussi par toutes les mancies : géomancie, aleuromancie, cléromancie, chiromancie, etc...
Et l’énorme succès de ces sciences divinatoires favorise l’apparition d’une méthode particulière d’examen du corps humain, que l’on doit à Jérome Cardan :
La métoposcopie :
Anatomiste et chiromancien passionné, auteur d’une autobiographie intitulée
« de propria vita » (1575), Cardan établit que d’après les traits et l’expression du visage, on peut déduire le caractère d’une personne .
La recherche d’une corrélation entre la constitution physique et la personnalité se poursuivra pendant toute la Renaissance.
Cette thèse sera reprise par Gall, médecin au XVIII e siècle, avec la phrénologie. Lombroso, célèbre criminaliste italien du XIX e siècle, tentera à son tour de prouver qu’il existe un lien entre la criminalité et la configuration du visage. De nos jours encore on chercher à reconnaître les indices anatomiques ou comportementaux sensés trahir une pathologie mentale ou une déviance sociale . Cardan est aussi à l’origine d’une autre méthode, beaucoup plus inspirée de la psychologie, et qui, plus tard, sera réellement reconnue pour ses vertus thérapeutiques : la « méthode Coué » .
Il en parle en ces termes: « Seule une conscience coupable rend l’homme malheureux, la fermeté d’esprit est d’un grand secours pour supporter nos maux et pour faire tourner la chance. Pour éviter d’être malheureux, il faut croire que l’on ne l’est pas ».
« Si tu es malade, il faut croire que tu ne l’es pas, te le répéter, le dire aux autres et recommencer » .
En dépit de sa croyance aux démons et à certaines pratiques divinatoires, Cardan a le mérite de reconnaître le pouvoir thérapeutique de la suggestion. Il conseille aux médecins, pour s’assurer de la réussite d’un traitement, de gagner le plus possible la confiance des malades :
« Pour qu’ils guérissent, il faut qu’ils aient confiance en lui, qu’il les persuade de leur prochaine guérison » .
Durant les siècles suivants, on verra se développer l’influence de la suggestion, d’une façon qui ne sera pas complètement éloignée de la magie, avec le mesmérisme et l’hypnose .
La Renaissance prête beaucoup d’intérêt à ces personnes qui sont présumées capables de soigner sans effectuer de traitement réel et sans utiliser de médication. Ce ne sont donc plus les Saints qui guérissent, mais des individus bien vivants, ayant reçus de Dieu le pouvoir d’agir sur les maladies.
C’est ainsi que les rois, anglais ou français, ont acquis la réputation de guérir les scrofules et les écrouelles, par simple attouchement. Ce sont les rois thaumaturges .
A la même époque, Greatrakes, un irlandais, rassemble des milliers de souffrants. Il est considéré comme un « élu de Dieu » capable d’accomplir des miracles. En fait, par une habile suggestion, il pratique surtout une forme de psychothérapie.
Aujourd’hui encore, la foule de guérisseurs, de chiropracteurs, de mages ou de gourous, bien supérieurs en nombre à nos médecins, attestent de l’efficacité des procédés surnaturels persuasifs.
L’attouchement, la chiromancie, l’astrologie et la suggestion ne sont donc pas des pratiques réservées à une époque précise de l’histoire. C’est une réaction humaine que de faire appel au surnaturel pour surmonter ses peurs, ses angoisses ou ses maladies .
2
LES PROGRES DE LA MEDECINE
Dans une époque encore entourée de superstitions et de crainte de possession, la médecine parvient malgré tout à avoir une attitude un peu plus scientifique.
Avec la possibilité de disséquer des cadavres - ce qui, auparavant, était interdit par crainte de laisser s’échapper l’âme - l’approche de l’anatomie devient plus réaliste. Léonard de Vinci réussit à faire des coupes du cerveau. Ses carnets de dessins seront très utilisés après sa mort.
André Vésale, médecin et chirurgien, pratique beaucoup de dissections de corps humains. C’est une véritable passion, chez lui, qui le pousse à voler les cadavres la nuit dans les cimetières.
Il publie une oeuvre énorme en 1543 : « Sept livres sur la structure du corps humain » .
Vésale corrige ainsi les erreurs de Galien, telles que la « côte manquante » de l’homme, les « lobes du foie », les « cavités du cœur » ou la « courbure du fémur » . Il différencie le cerveau humain de celui de l’animal et y distingue la substance blanche et la substance grise. Avec Vésale, l’anatomie devient une science à part entière.
Ambroise Paré, alors chirurgien dans les armées de François I er met au point une technique de ligature des artères après amputation, qui remplace la douloureuse cautérisation au fer rouge.
Il rédige un « Traité de la peste, de la petite vérole et de la rougeole » , dans lequel il considère ces fléaux comme des maladies et non pas comme des punitions divines. Il définit aussi plus précisément la notion de contagion.
3
L’HUMANISME, UNE APPROCHE DEMYSTIFIEE DE LA FOLIE
La soif de savoir, associée à un désir de liberté intellectuelle, fait naître de grands espoirs dans le progrès.
La science et la raison s’opposent aux pratiques magiques et aux explications démoniaques, pour aller dans le sens d’une meilleure connaissance du corps humain, du caractère, du comportement et des maladies.
La recherche de vérité ne passe plus par Dieu.
Un véritable esprit critique humaniste se développe et impose forcément un changement de la société, des coutumes et des modes de pensée, qui touche au problème de la folie et le remet au goût du jour. C’est ainsi qu’apparaît l’antithème du fou.
Brandt et Erasme vont se servir de la folie, non pas pour décrire l’insensé, le dément ou le malade qui souffre, mais pour réaliser une satire, une caricature des défauts et des paradoxes de la société.
-La Nef des Fous de SÉbastien Brandt (1494) :
C’est la Nef des pauvres, des errants, des « sans boussole »
(ou des déboussolés), « espèce de sans papiers d’autrefois », qui sont rejetés, exclus et accusés de transporter les fléaux comme la peste et la lèpre.
C’est une fiction littéraire écrite en vers:
« Les rues grouillent de fous
Qui battent la campagne
C’est pourquoi en ce jour
Je cherche à équiper
Toute une armée navale
Pour les embarquer tous ».
Brandt utilise l’image négative de la folie.
La déraison ne porte plus à rire comme au Moyen âge. Elle représente maintenant le désordre et la mort, puisque c’est l’humanité toute entière qui, symbolisée par cette Nef des fous, s’en va, insouciante, vers un naufrage inévitable.
-L’Eloge de la Folie d’Erasme (1509) :
C’est une réponse à la Nef des Fous.
Erasme réhabilite la folie en lui accordant une image positive :
« Si tous les hommes sont fous, un seul homme sensé ne pourrait être qu’un Fou véritable » .
La folie ne conduit plus l’humanité à un naufrage inévitable. Au contraire, elle délivre l’homme d’une sagesse trop excessive et du respect des lois trop rigides..
La déraison devient salutaire et équilibrante. Elle est le contre poids d’un conformisme qui s’avère de plus en plus pesant :
« Un sage sans passion, sourd à la voix de la nature, ne serait plus un homme... C’est une grande sagesse que de savoir être fou à propos » .
Erasme décrit le monde vu à travers les yeux de la folie : C’est un monde aussi cohérent que celui vu à travers les yeux de la raison.
La folie est une sagesse et celui qui la possède ne peut que mieux voir... Riche d’enseignement sur la vérité profonde de la nature humaine, elle adoucit les peines et les misères de l’existence en les rendant plus compréhensibles.
On prend conscience que la folie reste relative, puisque c’est toujours la société qui en fixe les limites.
Près d’un demi millénaire plus tard, le mouvement anti-psychiatrique parlera le même langage que celui d’Erasme, comme si, finalement, les considérations sociales portant sur la maladie mentale n’avaient pas évolué. Pourtant, à la suite d’Erasme, les philosophes et les écrivains humanistes s’orientent vers une révision du jugement porté sur les fous. La folie n’est pas qu’une simple déraison, elle apporte une meilleure connaissance de l’être humain. On se rend compte, par exemple, que l’espace séparant le fou du non fou est bien réduit ; le premier étant un peu le reflet du second.
En littérature, la façon de penser et de s’exprimer change.
Elle est animée d’un désir de liberté qui combat l’idée théologique de la vérité révélée du Moyen âge .
La religion et le sacré n’ont plus le pouvoir de tout expliquer. C’est avec les sentiments, la volition, l’expérience et le doute que l’on peut parler de l’être humain.
Et la philosophie, qui commence à faire des infidélités à l’Eglise, enseigne que l’homme, avant d’être intelligent, érudit et bon chrétien, est d’abord un organisme vivant qui doit apprendre à mettre toutes ses facultés, et surtout celles psychologiques, au service de sa vie.
Rabelais décrit les passions charnelles, ces pulsions fondamentales, que l’on passait sous silence depuis des siècles. Il y a cette vérité sur la nature humaine que l’on ne peut découvrir que par l’observation et l’expérience vécue.
Montaigne, en psychologue réaliste, décrit les sentiments, les caractères, les comportements. Il analyse les actions humaines comme dirigées par une force intérieure, une conscience organisatrice qui met tout au service de la vie.
Ses réflexions l’amènent à considérer que la folie n’est pas très éloignée de la normalité :
« Il n’y a qu’un demi-tour de cheville pour passer des plus excellentes manies aux plus détraquées » ( les Essais 1580).
Machiavel, comme Montaigne, délaisse l’abstraction. Les conseils qu’il donne au « Prince » (1513) se fondent sur une connaissance objective des interactions humaines. Les comportements sont décrits comme des phénomènes naturels, sans faire l’objet d’un jugement moral.
D’autres écrivains vont reconnaître cette part de folie inhérente à une nature humaine qui, jusqu’à présent, se voulait bien trop raisonnable :
Pascal : « Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie que de ne pas être fou ». ( Les pensées 1658)
La Fontaine : « On voit courir après l’ombre tant de fous qu’on n’en sait la plupart du temps le nombre » .
Fénelon : « Pour moi, je suis content de rire des fous, tous les hommes ne le sont-ils pas » ?
4
LES MEDECINS DEFENSEURS DES SORCIERES
Sans renier leur foi en Dieu et leur croyance au diable, quelques médecins n’approuvent pas les exécutions. Influencés par le courant humaniste littéraire, ils pensent que la science doit s’opposer à ces pratiques dignes d’une époque révolue.
Paracelse, alchimiste, astronome et médecin, célèbre pour les soins qu’il prodigue à Erasme, s’insurge contre l’autorité des anciens en matière médicale.
Selon lui, les maladies mentales, comme toutes les autres pathologies, résultent non pas de l’influence des astres ou des démons, mais de perturbations de la substance intérieure du corps, que l’on peut guérir avec des médicaments.
Il invente l’éther et fabrique beaucoup de remèdes dont il refuse de dévoiler le secret.
Il reconnaît à l’aimant des propriétés thérapeutiques et déclare obtenir des guérisons par le magnétisme.
Il constate aussi que la relation médecin malade joue un rôle important dans l’évolution des maladies.
Weyer, un autre médecin, s’occupe du Duc de Clèves qui souffre d’une dépression chronique.
En s’intéressant à de nombreux cas de sorcellerie et de possession, il tente de démontrer la fausseté des accusations. Il prouve que les sorcières sont bien souvent des malades mentales qui nécessitent des soins donnés par un médecin au lieu d’être interrogées et persécutées par des ecclésiastiques.
Il publie en 1563 un ouvrage intitulé « De l’imposture des démons » qui réfute point par point le Malleus malleficarum.
Comme Hippocrate, il soutient que ce sont les médecins eux-mêmes qui, quand ils sont incapables de guérir certaines maladies, font appel au démon pour les expliquer.
Et pendant longtemps encore, devant l’échec thérapeutique, on se contentera d’affirmer que cela tient au fait que le malade est « nerveux » ou « dérangé ».
-Classification des maladies mentales :
Dans le domaine clinique proprement dit, c’est encore la pensée galénique qui conserve tout son prestige
Jean Fernel, médecin de Henri II, classe ainsi les maladies mentales :
- Maladies avec fièvre :
Frénésie : par atteinte directe du cerveau.
Parafrénésie : par atteinte du nerf sympathique.
- Maladies sans fièvre :
Mélancolie : soit triste (états dépressifs)
soit avec lycanthropie
soit avec excitation (manie, délires de persécution )
- Affaiblissement mental :
Perte de l’intelligence due à une commotion, à une intempérie froide ou de naissance .
Etats stuporeux dus à une abondance de pituite.
Catalepsie.
L’hystérie et l’épilepsie sont classées à part.
Au cours de la Renaissance, même si l’Inquisition brûle énormément de sorcières, d’hérétiques et d’insensés, les progrès des sciences, la raison des philosophes démontrent que Satan n’y est pour rien dans les esprits dérangés et la folie.
La maladie mentale tente donc de s’arracher de ses anciennes parentés avec la sorcellerie et la démonologie pour être reconnue comme une pathologie naturelle dont on essaye de déterminer les causes et les effets.
Quelques hospices s’orientent déjà vers une indispensable prise en charge de la folie :
Bethleem en Angleterre, qui devient Bedlam en 1547, est un établissement réservé aux insensés.
L’ordre de St Jean de Dieu donne naissance aux hospices de la Charité, à Charenton, Senlis, Lyon, Lille, Dinan, etc...
L’ordre de la première Croix Rouge ouvre aussi des institutions.
Mais la bataille contre la superstition est encore loin d’être gagnée.